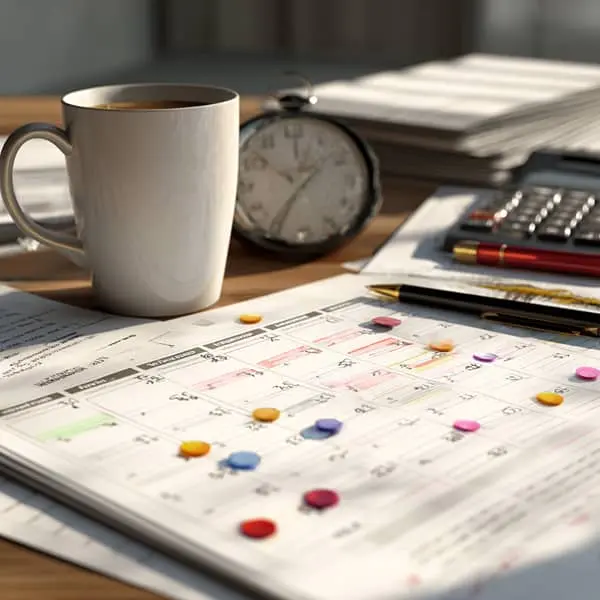Chaque année, de nombreux salariés repoussent leurs congés, parfois jusqu’à les perdre. Charge de travail, désintérêt, ou simple oubli : le phénomène des congés non pris soulève à la fois des questions juridiques et managériales. Pour l’employeur, il s’agit d’un équilibre délicat entre respect du droit du travail et gestion du bien-être. Alors, que faire quand un collaborateur ne prend pas assez de congés ?
La réglementation française sur la prise de congés
En France, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète.
Ces congés doivent être pris chaque année, sauf exceptions prévues par accord collectif ou convention. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés après consultation des représentants du personnel, et s’assurer que chaque salarié prenne bien ses congés.
Autrement dit, le droit au repos est une obligation : l’employeur ne peut pas simplement “laisser faire”. En cas de contrôle, il doit prouver qu’il a informé, encouragé et permis la prise effective des congés.
Les différents cas de figure
L’employé et l’employeur n’arrivent pas à trouver d’accord sur les dates de congés
Il arrive que le salarié souhaite poser ses congés à des dates qui ne conviennent pas à l’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur a le dernier mot, à condition de respecter un préavis d’un mois avant la période fixée.
L’important est de motiver le refus par des raisons objectives (continuité de service, pic d’activité, remplacement impossible) et de proposer des alternatives.
L’employé refuse de poser ses congés
Il arrive aussi parfois que certains salariés refusent tout simplement de prendre leurs congés payés. C’est une situation à risque :
- pour la santé du salarié,
- pour la responsabilité de l’employeur, tenu légalement d’assurer la sécurité et la santé au travail.
- et pour la gestion RH, car les congés accumulés deviennent un passif financier.
En cas de litige, l’employeur devra démontrer qu’il a bien invité le salarié à prendre ses congés et lui a donné les moyens de le faire.
Les raisons pour lesquelles un employé peut refuser de poser des congés
La surcharge de travail
C’est la raison la plus courante. Certains salariés craignent de revenir débordés ou estiment que leur absence désorganiserait l’équipe. Pourtant, le repos est un droit fondamental, et le Code du travail impose à l’employeur de veiller à ce qu’il soit respecté.
Un bon manager doit dédramatiser la prise de congés en rappelant que l’entreprise continue de tourner sans chaque collaborateur, et qu’un salarié reposé est plus productif et créatif.
L’envie de voir ses congés être payés
Certains employés pensent qu’en ne prenant pas leurs congés, ils pourront en demander le paiement à leur départ.
En réalité, c’est faux : le paiement des congés payés non pris n’est possible qu’en cas de rupture du contrat. Dans ce cas, ils recevront le paiement de leurs congés avec le solde de tout compte lors du départ.
En dehors de cette situation bien spécifique, les congés non pris sont perdus, sauf si un accord collectif autorise un report exceptionnel (par exemple en cas d’arrêt maladie).
Quels sont les risques pour l’entreprise ?
Ne pas veiller à la prise effective des congés expose l’employeur à plusieurs risques, qu’ils soient d’ordre juridique, financier ou bien liés à la QVCT :
- Sanctions de l’inspection du travail en cas de non-respect du Code du travail.
- Risque financier : si un salarié quitte l’entreprise avec un stock de congés non pris, ils devront être payés sous forme d’indemnité compensatrice.
- Risque social et managérial (QVCT) : accumulation de fatigue, risques psychosociaux (RPS), démotivation, hausse de l’absentéisme et du turnover, dégradation du climat social et de la marque employeur.
- Atteinte au droit à la déconnexion : des pratiques ou injonctions implicites qui découragent la prise de congés et la coupure hors temps de travail peuvent être contraires au droit à la déconnexion (prévu par le Code du travail et les accords QVCT/NAO) et engager la responsabilité de l’employeur.
- Contentieux individuels : un salarié surmené peut invoquer un manquement à l’obligation de sécurité, voire demander réparation de son préjudice (heures supplémentaires non compensées, atteinte à la santé,…)
Comment gérer la situation ?
Mettre en place des rappels réguliers sur la perte potentielle des congés non posés
Une communication régulière sur les soldes de congés restants permet d’éviter les mauvaises surprises.
Certaines entreprises envoient des alertes automatisées via leur SIRH ou RH logiciel à chaque fin de trimestre.
💡 Astuce RH : indiquez clairement sur les bulletins de paie le nombre de jours de congés acquis, pris et restants.
Rappeler la réglementation à l’employé
Le manager ou le service RH peut faire un rappel au salarié concernant la réglementation sur les congés imposés par l’employeur :
- Les congés payés sont un droit mais aussi une obligation,
- Ils doivent être pris avant la fin de la période légale (souvent fixée au 31 mai pour les congés N-1),
- Leur non-utilisation peut entraîner leur perte sans compensation.
Cette discussion peut aussi être l’occasion d’aborder les freins du salarié et d’y apporter des solutions concrètes (planification plus souple, délégation, ajustement de charge).
Est-ce possible d’imposer des congés à ce salarié spécifiquement ?
Oui, dans certaines situations.
L’employeur peut imposer la prise de congés à un salarié, à condition de respecter les délais de prévenance et les règles collectives.
L’article L3141-16 du Code du travail lui en donne la possibilité, notamment pour la période estivale ou lors d’une fermeture annuelle.
Cependant, cette démarche doit rester exceptionnelle et collective, sauf cas particulier (épuisement du compteur avant clôture, report impossible, etc.).
Exemple d’un employé qui a voulu de faire payer 255 jours de congés à son départ
Un cas souvent cité : en 2023, un salarié d’une grande entreprise française a demandé à être indemnisé pour 255 jours de congés non pris accumulés sur plusieurs années.
L’employeur s’y est opposé en démontrant avoir informé régulièrement le salarié de ses soldes, des dates limites et des conséquences d’une non-prise, tout en lui proposant des plannings alternatifs.
Le juge a retenu que l’entreprise avait rempli son obligation d’information et d’incitation (rappels, traçabilité, possibilités réelles de départ), ce qui a limité sa responsabilité.
Leçons pratiques :
- Conservez une traçabilité écrite (campagnes d’e-mails, notifications SIRH, attestations de refus, propositions de dates).
- Offrez de véritables options (créneaux, relais, priorisation) pour rendre la prise de congés possible sans pénaliser l’activité.
- Intégrez la logique QVCT : des congés effectivement pris, une déconnexion respectée, et un climat social préservé coûtent toujours moins cher qu’un contentieux ou un épuisement.
📝 En résumé
- En France, les congés payés sont un droit et une obligation : ils doivent être pris chaque année.
- L’employeur doit encourager activement leur utilisation et peut, si nécessaire, imposer des dates dans le respect du Code du travail.
- Le paiement des congés non pris n’est possible qu’en cas de départ de l’entreprise.
- Des rappels réguliers et une communication claire permettent d’éviter les situations de blocage.
- Enfin, une bonne politique RH valorisant l’équilibre vie pro/vie perso reste le meilleur levier pour inciter les salariés à déconnecter.