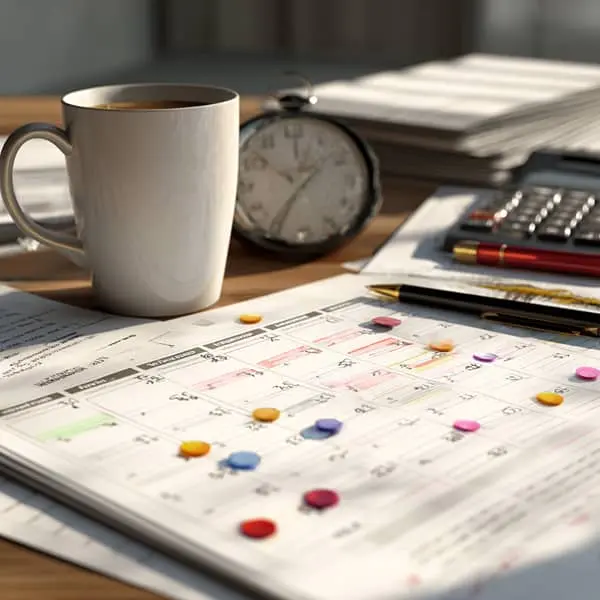Les congés imposés permettent à l’employeur de décider des dates des congés payés de ses collaborateurs. Mais sous certaines conditions. Quelles sont-elles ? Combien de congés l’employeur peut-il imposer ? Un salarié a-t-il le droit de refuser les congés qu’on lui impose ? On répond à toutes vos questions.
Est-ce que l’employeur a le droit d’imposer des congés ?
En principe, l’employeur est en droit d’imposer des congés payés à ses salariés, mais ce droit est encadré par le Code du travail et, dans certains cas, par les conventions collectives ou accords d’entreprise.
Oui, sous certaines conditions
L’article L3141-15 du Code du travail précise que l’employeur détermine les dates des congés, après consultation du CSE (comité social et économique) lorsqu’il existe. Il doit également prendre en compte la situation familiale et personnelle des salariés (présence d’enfants scolarisés, conjoint également en congé…).
En pratique, cela signifie que :
- L’employeur fixe la période de prise des congés payés ;
- Il peut imposer des congés lors d’une fermeture de l’entreprise (par exemple en août ou pendant les fêtes de fin d’année) ;
- Il peut également contraindre un salarié à poser des jours de congés en cas de baisse d’activité, travaux ou circonstances exceptionnelles (notamment pendant la crise sanitaire du Covid-19, où une ordonnance a autorisé plus de flexibilité).
En revanche, ce droit n’est pas absolu : l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un mois, sauf accord collectif prévoyant un autre délai, et ne peut pas modifier les dates fixées moins d’un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (activité imprévisible, force majeure).
Comment l’ordre de départ en congé est-il fixé en entreprise ?
Lorsque plusieurs salariés souhaitent partir en congé sur la même période, l’employeur doit établir un ordre des départs. Cet ordre n’est pas arbitraire : il doit répondre à des critères objectifs prévus par le Code du travail (article L3141-16) et, le cas échéant, par les conventions collectives ou accords d’entreprise.
Ainsi, l’employeur doit tenir compte notamment :
- de la situation familiale du salarié (présence d’enfants à charge, conjoint ou partenaire en congé à la même période, garde alternée…) ;
- de son ancienneté dans l’entreprise ;
- de la possibilité pour le salarié de bénéficier déjà de congés à d’autres moments de l’année.
Une fois l’ordre arrêté, l’employeur doit le communiquer clairement aux salariés, par voie d’affichage ou tout autre moyen accessible à tous. Cet ordre devient opposable : le salarié ne peut s’y soustraire, sauf à justifier d’une raison légitime ou à obtenir un accord amiable pour modification.
Quelle durée peut être imposée par l’employeur ?
Techniquement, l’employeur peut imposer les dates de l’intégralité des 5 semaines de congés payés annuels que le salarié doit prendre. Néanmoins, il ne peut pas exiger qu’elles soient prises en une seule fois.
Le Code du travail impose que la durée maximale d’un congé payé imposé soit de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines consécutives.
Sur quelle période les congés peuvent être imposés ?
En règle générale, les congés payés doivent être pris pendant la période fixée par l’employeur, après consultation du CSE lorsqu’il existe. Le Code du travail prévoit que cette période s’étend du 1er mai au 31 octobre, sauf dispositions conventionnelles différentes.
L’employeur peut donc imposer des congés dans ce cadre, mais certaines situations particulières permettent d’aller au-delà :
- fermeture annuelle de l’entreprise (souvent en août ou durant les fêtes de fin d’année) ;
- travaux, baisse d’activité ou circonstances exceptionnelles (ex. mesures prises lors de la crise sanitaire) ;
- accord collectif ou d’entreprise prévoyant une autre organisation des congés.
En dehors de ces cas, l’employeur ne peut pas contraindre un salarié à poser ses congés en dehors de la période fixée par la loi ou par accord collectif.
Quel est le délai de prévenance pour les congés payés imposés ?
Le Code du travail impose à l’employeur de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois. Cela signifie que le salarié doit être informé de ses dates de congés au moins 30 jours avant son départ.
Toutefois, un accord collectif peut prévoir un délai plus court, à condition qu’il soit clairement défini et respecté. En cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, activité imprévisible, fermeture soudaine), l’employeur peut exceptionnellement déroger à ce délai, mais il devra justifier sa décision.
Ce délai de prévenance est essentiel, car il permet au salarié d’anticiper l’organisation de sa vie personnelle et familiale.
L’employé peut-il refuser les congés payés imposés ?
En principe, le salarié ne peut pas refuser les congés imposés par l’employeur dès lors que ce dernier a respecté la réglementation : consultation du CSE, respect de la période légale ou conventionnelle, délai de prévenance d’un mois, prise en compte de la situation familiale.
Un refus sans motif légitime peut être assimilé à une insubordination, susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire (avertissement, voire faute grave selon la gravité de la situation).
En revanche, l’employé peut légitimement contester les congés imposés dans certains cas :
- si l’employeur ne respecte pas le délai légal de prévenance ou les règles prévues par l’accord collectif ;
- si la décision ne prend pas en compte sa situation familiale particulière (par exemple, un salarié qui a la garde exclusive d’un enfant scolarisé et à qui on impose des congés hors vacances scolaires sans justification) ;
- si l’imposition des congés va au-delà des pouvoirs légaux de l’employeur (par exemple, obligation de poser des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sans qu’un accord collectif ne l’autorise, ou au-delà de 24 jours ouvrables consécutifs).
Dans ces hypothèses, le salarié doit privilégier le dialogue avec l’employeur et, en cas de désaccord persistant, peut saisir les représentants du personnel ou, en dernier recours, le conseil de prud’hommes.
Cas spécifiques
L’employé n’a pas assez de congés payés en réserve
Si un salarié ne dispose pas d’assez de jours de congés payés pour couvrir la période imposée par l’employeur (par exemple lors d’une fermeture annuelle de l’entreprise), plusieurs options existent :
- Utilisation des jours de RTT (s’ils sont prévus par l’accord d’entreprise) : l’employeur peut demander au salarié d’y recourir en priorité.
- Recours aux congés sans solde : à défaut de droits acquis suffisants, l’employeur peut imposer au salarié de rester en congé non rémunéré pendant la période de fermeture.
- Mobilisation du compte épargne-temps (CET) : si l’entreprise en dispose, le salarié peut utiliser ses jours épargnés.
Dans tous les cas, l’employeur doit informer clairement le salarié des modalités retenues. Le salarié ne peut pas refuser la fermeture, mais il peut négocier la solution la plus adaptée à sa situation (RTT, congé anticipé, congé sans solde…).
Cas de la rupture conventionnelle
Lorsqu’une rupture conventionnelle est signée, les congés payés imposés diffèrent selon la situation :
- Congés acquis et non pris avant la date de rupture : ils donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, réglée lors du solde de tout compte.
- Congés imposés par l’employeur avant la rupture : le salarié est tenu de les prendre si le délai de prévenance et les règles légales ont été respectés, même si la rupture intervient peu après.
- Congés fixés après la date de rupture : ils n’ont plus lieu d’être, puisque le contrat prend fin à la date convenue.
En pratique, l’employeur et le salarié peuvent négocier la prise effective des congés avant la fin du contrat ou prévoir leur indemnisation.