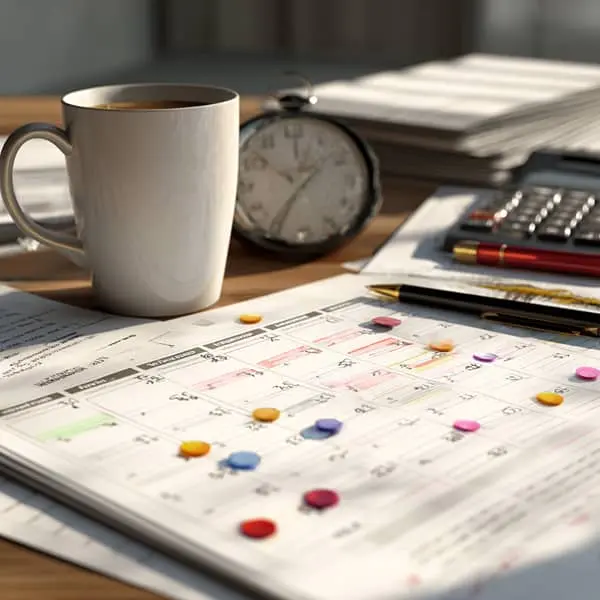En droit du travail, il existe principalement deux types de contrats : le contrat à durée indéterminé (CDI) et le contrat à durée déterminé (CDD). Ce dernier est régi par des règles spécifiques, destinées à limiter les dérives. Focus sur les principales conditions qui encadrent son usage.
Le fonctionnement du CDD
À contrario du CDI, considéré comme “la forme normale et générale de la relation de travail” selon le Ministère du Travail, le CDD désigne un contrat limité dans le temps, dédié à l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En clair, la différence entre CDI et CDD repose sur la connaissance de la date de fin de contrat.
Les différents types de CDD
Le recours à un CDD est très encadré par la loi et n’est possible que dans des cas bien spécifiques, parmi lesquels :
- Remplacement d’un salarié absent : pour pallier l’absence temporaire d’un salarié en congé maternité, arrêt maladie, congés payés ou en formation. Ce type de CDD prend fin dès le retour du salarié remplacé.
- Emploi saisonnier : destiné à répondre aux besoins liés à des activités récurrentes et prévisibles selon les saisons. Il est couramment utilisé dans l’agriculture (vendanges, récoltes), le tourisme, l’hôtellerie-restauration, ou encore les stations de ski.
- Accroissement temporaire d’activité : lorsqu’une entreprise fait face à une hausse ponctuelle de son activité (commande exceptionnelle, pic de production, lancement d’un nouveau produit), ou doit compenser un turnover élevé au sein de ses équipes, elle peut recourir à un CDD pour faire face à cette surcharge.
- Contrat à objet défini (ou « CDD de mission ») : réservé aux cadres ou ingénieurs, ce contrat est conclu pour la durée d’un projet clairement identifié. Sa durée peut aller jusqu’à 36 mois. Il prend fin une fois l’objectif atteint.
- Emplois à caractère occasionnel ou non durable : certains postes par nature temporaires (ex. : animateurs lors d’un événement, figurants pour un tournage, etc.) peuvent justifier un CDD.
- Remplacement d’un chef d’entreprise ou d’un professionnel libéral : lorsqu’un travailleur indépendant ou un dirigeant est absent temporairement, un CDD peut être conclu pour assurer la continuité de son activité.
- Le CDD senior : c’est le CDD pour les seniors, un contrat prévu pour favoriser le retour à l’emploi pour les salariés âgés. Il peut être conclu avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé.
Durée d’un CDD
Dès la signature, le contrat de travail en CDD mentionne une date de départ, ou à minima une temporalité. Il prend donc fin à la date indiquée, ou bien lorsque l’objectif a été réalisée – par exemple, dans le cas d’un retour d’une femme en congé maternité.
La durée varie donc en fonction du CDD, bien qu’il soit en général conclu pour 18 mois, renouvellement inclus. Certains types de CDD peuvent avoir une durée maximale plus courte ou plus longue – par exemple, le CDD à objet défini, qui peut aller jusqu’à 36 mois.
Quant à la période d’essai, elle dure :
- 2 semaines maximum lorsque le contrat est inférieur ou égal à six mois
- 1 mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois.
Congés payés
Les salariés en CDD bénéficient des mêmes droits que ceux en CDI en matière de congés payés – à savoir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Et ce, indépendamment de la durée du contrat ou du temps de travail.
Modalités de prise des congés
En théorie, le salarié peut prendre ses congés pendant le contrat si la durée le permet, avec l’accord de l’employeur et dans le respect de la période de prise des congés.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Lorsque les congés ne sont pas pris, l’employeur verse une indemnité compensatrice à la fin du contrat. Elle correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat, incluant salaire de base, primes, heures supplémentaires, etc.
Cette indemnité figure clairement sur le solde de tout compte remis au salarié à la fin de son CDD.
Cas particuliers
- En cas de renouvellement de CDD, les droits à congés continuent de s’accumuler, mais l’indemnité n’est versée qu’à la fin du dernier contrat, sauf si les congés ont été effectivement pris entre-temps.
- Les périodes d’absence non rémunérées (arrêt maladie, congé parental non payé…) ne sont pas prises en compte dans le calcul des congés payés.
Rémunération
Le salarié en CDD bénéficie des mêmes conditions de rémunération que le salarié en CDI, pour un poste équivalent dans l’entreprise. Cela inclut :
-
Le salaire de base, qui ne peut être inférieur :
-au SMIC en vigueur (salaire minimum interprofessionnel de croissance),
-ou au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable à l’entreprise, si ce dernier est supérieur au SMIC.
-
Les avantages collectifs applicables dans l’entreprise : titres-restaurant, indemnités de transport, remboursement de frais professionnels, mutuelle d’entreprise obligatoire, participation, intéressement, etc.
-
Les primes : le salarié en CDD peut percevoir les mêmes primes que les salariés en CDI (prime d’ancienneté, prime de performance, 13ème mois…), à condition que leur versement ne soit pas lié à une condition d’ancienneté ou de durée minimale de présence non remplie.
-
Les heures supplémentaires : elles sont rémunérées dans les mêmes conditions que pour un salarié en CDI, avec les majorations prévues par la loi ou la convention collective.
À noter que, selon le principe d’égalité de traitement, un salarié en CDD ne peut être payé moins qu’un salarié en CDI effectuant le même travail, avec les mêmes qualifications et responsabilités.
Arrêt maladie
Un salarié en CDD bénéficie des mêmes droits qu’un salarié en CDI en cas de maladie. L’employeur ne peut pas rompre un CDD en raison d’un arrêt maladie, sauf faute grave ou force majeure.
- Déclaration et indemnisation
L’arrêt doit être déclaré sous 48 heures à l’employeur et à la Sécurité sociale. Si le salarié remplit les conditions (ancienneté, heures travaillées), il peut percevoir des indemnités journalières à partir du 4ème jour.
- Maintien de salaire
Selon la convention collective ou un accord d’entreprise, l’employeur peut compléter tout ou partie de la rémunération. Des conditions d’ancienneté peuvent s’appliquer.
- Effet sur le contrat
L’arrêt maladie ne prolonge pas la durée du CDD, sauf clause spécifique. Le contrat prend fin à la date prévue, même si l’arrêt est en cours.
Renouvellement d’un CDD
Combien de fois est-ce possible de renouveler un CDD ?
Le Code du travail autorise, en principe, le renouvellement d’un CDD deux fois maximum, à condition que cela soit prévu dans le contrat initial ou qu’un avenant soit signé avant le terme du contrat en cours.
Les conditions :
- La durée totale du CDD, renouvellements inclus, ne peut excéder 18 mois, sauf exceptions prévues par la loi (remplacement d’un salarié absent, contrats conclus à l’étranger…).
- Pour certains cas spécifiques, comme le CDD à objet défini, la durée maximale peut aller jusqu’à 36 mois, mais il n’est pas renouvelable.
Une fois la limite des deux renouvellements atteinte, l’employeur ne peut pas conclure un troisième CDD pour le même poste avec le même salarié, sans respecter un délai de carence (délai entre deux contrats). À défaut, cela peut entraîner la requalification du CDD en CDI par le conseil de prud’hommes.
Dans ce cas, le passage au CDI donne lieu à un nouveau contrat de travail ou un avenant. Il permet de sécuriser la relation de travail sur le long terme, et annule le versement de la prime de précarité prévue à la fin d’un CDD.
Quelles sont les primes lors d’un renouvellement de CDD ?
Le renouvellement d’un CDD ne donne pas droit à une prime spécifique, puisqu’il prolonge simplement la relation de travail existante. Toutefois, certaines primes peuvent s’appliquer en fonction de la convention collective ou des accords d’entreprise, comme :
- Prime d’ancienneté : si elle est prévue par la convention, elle continue de s’accumuler au fil des renouvellements.
- Prime de performance ou 13ème mois : le salarié en CDD renouvelé peut y avoir droit, selon les mêmes critères que les CDI (résultats, présence continue,…).
- Prime exceptionnelle : dans certains cas (objectifs atteints, pic d’activité), l’entreprise peut décider de verser une prime.
La prime de précarité, elle, ne s’applique qu’à la fin du dernier contrat si le salarié ne passe pas en CDI.
Que se passe t-il pour les congés accumulés lors d’un renouvellement de CDD ?
Lorsqu’un CDD est renouvelé, les droits à congés continuent de s’accumuler sans interruption. En effet, il s’agit d’une poursuite du même contrat de travail. Deux cas possibles :
- Les congés sont pris pendant le CDD : si la durée du contrat (et le rythme de travail) le permet, le salarié peut poser ses congés avec l’accord de l’employeur.
- Les congés ne sont pas pris : une indemnité compensatrice de congés payés est versée à la fin du dernier contrat, calculée sur l’ensemble de la période travaillée (CDD initial + renouvellements).
L’indemnité représente 10 % de la rémunération brute totale (incluant salaires, primes, heures supplémentaires…).
Les primes lors d’un contrat CDD
Un salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD) peut percevoir diverses primes, au même titre qu’un salarié en CDI, sous certaines conditions. Ces primes peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective, ou encore des usages dans l’entreprise.
Prime de précarité / fin de contrat
La prime de précarité, aussi appelée indemnité de fin de contrat, est spécifiquement liée au statut de salarié en CDD. Elle vise à compenser l’absence de stabilité que connaît ce type de contrat, par opposition au CDI.
Elle est obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi, et correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat, incluant salaire de base, primes, heures supplémentaires, etc.
Cette prime est versée à la fin du CDD, en même temps que le solde de tout compte. Elle figure également sur le bulletin de paie final.
L’éligibilité à la prime de précarité
Tous les salariés en CDD sont en principe éligibles à la prime de précarité, dès lors que :
- Le contrat arrive à son terme sans qu’un CDI ne soit proposé,
- Et que le motif du contrat n’entre pas dans les cas d’exonération.
Comment rompre un CDD ?
Le contrat à durée déterminée ne peut pas être rompu librement comme c’est le cas pour un CDI. En principe, il doit aller jusqu’à son terme. Toutefois, certaines situations spécifiques permettent une rupture anticipée, encadrée par le Code du travail :
- D’un commun accord entre les parties : employeur et salarié peuvent mettre fin au contrat à tout moment, à condition de formaliser cet accord par écrit.
- Faute grave de l’une des parties : qu’il s’agisse de l’employeur ou du salarié, une faute grave justifie la rupture immédiate du contrat (insubordination, harcèlement, abandon de poste…).
- Force majeure : un événement extérieur, imprévisible et insurmontable (catastrophe naturelle, incendie…) peut entraîner l’impossibilité de poursuivre le contrat.
- Inaptitude constatée par le médecin du travail : si aucun reclassement n’est possible, l’employeur peut mettre fin au contrat.
- Demande du salarié : si ce dernier justifie d’une embauche en CDI (chez un autre employeur), il peut rompre son CDD de manière anticipée, sous réserve de respecter un préavis (généralement calculé à raison d’un jour par semaine de contrat restant à courir, dans la limite de 2 semaines).
Si l’une des parties rompt le CDD sans respecter les motifs légaux, elle s’expose à des sanctions financières :
- L’employeur peut être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts équivalents au montant des salaires restants jusqu’au terme initial du contrat.
- À l’inverse, si le salarié rompt son contrat de manière injustifiée, l’employeur peut aussi demander réparation.
Préparer le contrat à signer
La rédaction d’un contrat CDD doit respecter des exigences strictes sous peine de requalification en CDI. L’employeur est tenu de remettre un contrat écrit au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Le contrat doit impérativement mentionner :
- Le motif précis du recours au CDD (par exemple : remplacement de Mme X en congé maternité, accroissement temporaire d’activité…)
- La date de début et la date de fin du contrat, ou la durée minimale si la date de fin est incertaine.
- Le poste occupé, la qualification du salarié, sa rémunération (salaire de base + primes éventuelles)
- Le nom et l’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise
- La durée de la période d’essai, si elle est prévue
- Les conditions de renouvellement éventuel
- L’existence ou non d’un temps partiel
- Le lieu de travail, les horaires, les avantages sociaux éventuels (tickets-restaurants, mutuelle…)
- L’intitulé de l’assurance chômage à laquelle l’employeur est affilié