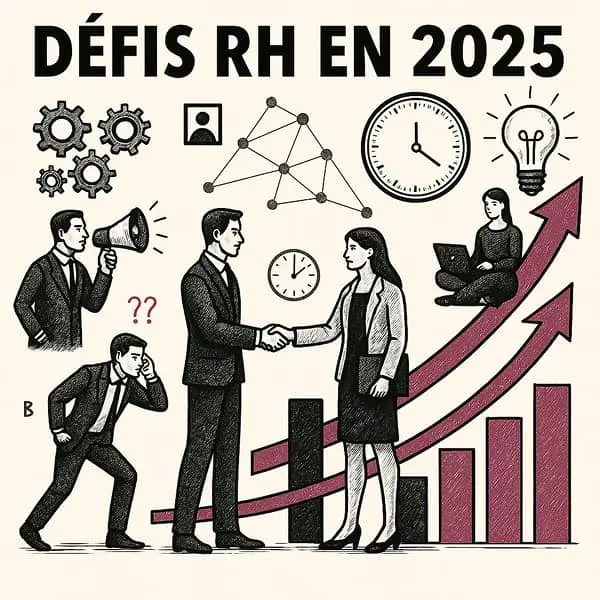Une collaboratrice vous annonce qu’elle est enceinte : une excellente nouvelle, qui implique toutefois certaines obligations du côté employeur. Ce dernier doit en effet garantir à sa salariée des conditions de travail adaptées, et ce pour assurer le bon déroulement de la grossesse. Focus sur vos droits et vos devoirs d’employeur avant, pendant et après l’accouchement.
La déclaration de grossesse
Quelle est l’obligation d’informer l’employeur de sa grossesse ?
Une salariée enceinte n’est pas légalement tenue d’en informer son employeur. Sans déclaration de grossesse, la salariée ne peut toutefois pas bénéficier des droits légaux et conventionnels liés à sa situation, ni prétendre à un congé maternité.
Elle peut, si elle le décide, l’annoncer à tout moment de sa grossesse, que ce soit à l’écrit ou verbalement. Dans ce cas, elle devra fournir un justificatif médical attestant de son état, ainsi que la date présumée de l’accouchement. Ce document devra être remis en main propre ou par courrier, en précisant les dates de son congé maternité.
Selon la loi, la collaboratrice doit prévenir son employeur à minima :
- 6 semaines avant la date de son accouchement pour un premier ou un deuxième enfant ;
- 8 semaines pour un troisième enfant ;
- 12 semaines pour des jumeaux ;
- 24 semaines pour des triplés et au-delà.
À noter qu’en tant qu’employeur, vous êtes soumis à une obligation en termes de confidentialité et ne devez divulguer la grossesse sous aucun prétexte – à moins que la collaboratrice elle-même ait décidé de rendre l’annonce publique. Dans le cas échéant, vous êtes passible de sanctions.
Préparer le congé maternité
Une fois que vous serez averti de la grossesse de la salariée et aurez reçu le certificat médical reçu, vous devrez prendre le temps de discuter avec votre collaboratrice pour anticiper son congé maternité.
Selon la loi, vous ne pouvez pas vous opposer à son départ, pour quel motif que ce soit. En effet, le congé maternité est une obligation légale, aussi bien pour l’employeur que pour la salariée. Sa durée varie en fonction des situations :
- 1ère ou 2ème naissance : 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal, soit 16 semaines au total.
- 3ème naissance : 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé postnatal, soit 26 semaines au total.
- Naissance de jumeaux : 12 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal, soit 34 semaines au total.
- Naissance simultanée de plus de deux enfants : 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal, soit 46 semaines au total.
La salariée peut choisir de répartir ses congés entre la période prénatale et postnatale. Il est formellement interdit d’employer une femme enceinte pendant au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement.
Aménagement du temps de travail
Absences médicales autorisées
L’employeur devra également autoriser les absences médicales, notamment lorsque la salariée doit se rendre à des examens obligatoires. Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif et ne doit pas donner lieu à une baisse de la rémunération.
À date, sept examens médicaux sont obligatoires : un examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse, puis un suivi mensuel à partir du 1er jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement.
Ces mesures bénéficient également aux salariées engagées dans un parcours d’assistance médicale à la procréation.
Temps de pause supplémentaire
À contrario du secteur public, au sein duquel est prévu une réduction d’une heure de travail à partir du 3ème mois de grossesse, rien n’est prévu pour le secteur privé.
Il existe toutefois des dispositions particulières selon les Conventions collectives et les accords d’entreprise. Il est donc conseillé de se renseigner avant d’aborder le sujet.
Accès au télétravail
Si l’accès au télétravail pour les salariées enceintes n’est pas rendu obligatoire par la loi, l’accord collectif ou la charte spécifique au télétravail doit prévoir une mention à ce sujet. Dans le cas où l’employeur décide de refuser l’accès au télétravail pour la salariée en poste, il devra toutefois justifier sa décision.
Adaptation du poste de travail et des missions
Garantir la sécurité de la salariée enceinte
Comme pour les autres salariés, l’employeur doit garantir la sécurité de sa collaboratrice dans le cadre de l’exercice de son travail. Cela peut impliquer de mener certains ajustements, ce que soit des changements d’horaires, le recours au télétravail, ou même la modification de certaines missions, en particulier si celles-ci sont physiques.
Changement ou aménagement éventuel de poste
Dans certains cas, l’employeur peut être amené à changer les missions ou le poste de sa salariée :
- Travail de nuit : vous devez muter la collaboratrice sur un poste de jour, sur sa demande ou bien sur les conclusions écrites de la médecine du travail.
- Poste à risques : si le poste implique de travailler dans des locaux avec une température très basse, de manipuler des produits dangereux, ou d’être exposé à des radiations, alors vous devez automatiquement lui proposer un autre poste compatible avec son état. Et ce jusqu’au début du congé maternité.
- Poste inadapté : si son état de santé le requiert, vous devrez affecter la collaboratrice enceinte à un tout autre emploi (que ce soit sur sa demande, ou à votre initiative après les recommandations de la médecine du travail). Sans poste adapté disponible, vous devez suspendre le contrat de la salariée en l’information des raisons pour lesquelles le changement de poste est impossible. La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération.
À noter que ce changement est temporaire, et qu’il devra prendre fin au retour du congé maternité – ou si l’état de santé de la salariée le permet.
Recrutement en CDD
Le départ en congé maternité d’une salariée peut nécessiter de repenser temporairement l’organisation du travail. Si son poste ne peut être laissé vacant, vous avez la possibilité de recruter un CDD afin d’assurer la continuité de l’activité.
Le remplacement d’un salarié absent pour cause de congé maternité constitue un motif légitime de recours au CDD, conformément à l’article L1242-2 du Code du travail. Ce CDD peut débuter avant le départ effectif de la salariée, notamment pour permettre une passation ou une formation.
La rédaction du contrat est essentielle :
- Il doit mentionner explicitement le motif du recours (remplacement d’une salariée en congé maternité).
- Il doit nommer la salariée remplacée, et préciser la date prévisionnelle de son retour.
- Il peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée minimale, avec une clause de renouvellement, si besoin.
Pour faire face à des besoins urgents ou à des délais restreints, il peut être judicieux de sourcer un profil en CDD. Cela permet d’identifier rapidement un profil adapté pour occuper le poste en CDD et garantir une transition fluide au sein de l’équipe.
Pendant le congé maternité
Ne pas solliciter la salariée
Comme indiqué précédemment, l’employeur ne peut en aucun cas faire travailler la salariée durant une période totale de 8 semaines entourant son accouchement. Cela signifie qu’il est strictement interdit de la solliciter sur ses missions, et a fortiori de lui en confier, même si elle y consent.
Maintenir la rémunération
Durant la période légale du congé maternité, une salariée justifiant d’au moins six mois d’ancienneté bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. Ce maintien est effectué sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et, le cas échéant, par les régimes de prévoyance.
En revanche, si la condition d’ancienneté n’est pas remplie, la salariée ne perçoit pas de maintien de salaire de la part de l’employeur. Elle peut toutefois bénéficier des indemnités journalières de la Sécurité sociale, sous réserve de remplir les critères requis.
Sachez par ailleurs que la collaboratrice a le droit aux mêmes évolutions salariales que n’importe quel autre collègue, et peut donc percevoir une augmentation ou une prime si celles-ci sont prévues par son contrat de travail.
Préparer la reprise d’activité
Le retour d’une collaboratrice après un congé maternité constitue une étape importante à anticiper avec soin. Cette période de transition demande une organisation rigoureuse et une attention particulière pour garantir une reprise progressive et efficace, à la fois pour la salariée et pour l’équipe :
- Anticiper en amont : Quelques semaines avant la date prévue de reprise, préparez un point de situation en interne. État d’avancement des projets, missions en cours, évolutions éventuelles au sein de l’équipe ou de l’organisation : ce point permettra d’accueillir la salariée dans de bonnes conditions.
- Prévoir un temps de passation : Dans le cas où son poste est occupé par un CDD, il est judicieux de prévoir une réunion pour faciliter la transition et la reprise des dossiers en cours.
- Accompagner les premiers jours : Il est essentiel de prévoir un temps d’adaptation, particulièrement si l’environnement, les outils ou les procédures ont évolué durant l’absence. Un accompagnement managérial bienveillant est alors un levier majeur de remobilisation.
Pas de licenciement possible
Une salariée en congé maternité est protégée contre tout licenciement. Cela signifie que, pendant toute la durée du congé, l’employeur ne peut sous aucun prétexte lui demander de quitter l’entreprise.
Avant cette période (à savoir dès l’annonce de la grossesse), la salariée enceinte bénéficie aussi d’une protection relative, mais pas absolue. Si le licenciement est théoriquement possible, il est fortement encadré par la loi.
Après le congé maternité
Réaffecter la salariée à son poste
Si des changements de mission ou de poste ont été établis pendant la grossesse de la salariée, ils doivent prendre fin à son retour. La collaboratrice doit reprendre son poste tel qu’il l’était avant son départ en congé maternité. À ce titre, la rémunération doit être, au minimum, équivalente.
Un entretien professionnel obligatoire
En tant qu’employeur, vous êtes tenu par le Code du Travail de préparer un entretien professionnel et de le proposer à votre collaboratrice à son retour de congé maternité. Celui-ci doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle de la salariée, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Ce point doit aboutir sur la rédaction d’un document, à remettre à la salariée.
Les droits de la salariée à son retour
À son retour de congé maternité, la collaboratrice bénéficie de plusieurs droits :
- Accorder un congé parental en cas de besoin : À l’issue du congé maternité, la mère peut décider de prolonger son absence en sollicitant un congé parental. Ce congé lui permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant, tout en conservant son lien contractuel avec l’entreprise.
- Examen médical de reprise d’activité : Au plus tard dans les 8 jours qui suivent sa reprise, la salariée doit être soumise à un examen de reprise réalisé par la médecine du travail.
- Rupture du contrat sans préavis : Si la collaboratrice le souhaite (et dans un délai de deux mois après la naissance du bébé), elle peut rompre son CDI sans délai de préavis pour élever son enfant.
- Aménagement pour l’allaitement : Pendant une durée maximale d’un an à compter de la naissance de l’enfant, la salariée a le droit de bénéficier d’une heure par jour de travail pour allaiter son bébé. Cette heure peut être utilisée en deux périodes de 30 minutes. Si l’entreprise met à disposition un local dédié à l’allaitement, ce temps peut être pris sur le lieu de travail. À défaut, la salariée peut quitter l’entreprise pendant ce temps, sans que celui-ci soit rémunéré, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
- Droit aux congés payés non pris : Les congés payés acquis avant ou pendant le congé maternité ne sont pas perdus. La salariée peut en demander le report à son retour, sans que cela n’affecte ses droits. De plus, la période de congé maternité est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
- Maintien des avantages liés à l’ancienneté : À son retour, la collaboratrice doit retrouver l’intégralité des avantages qu’elle avait acquis avant son départ, y compris ceux liés à l’ancienneté (primes, progression salariale, évolution de poste…).