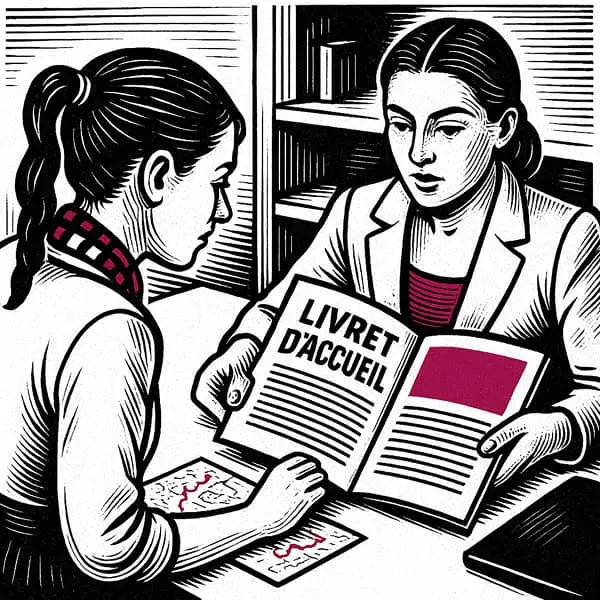Selon une étude du cabinet Anywr, un peu plus d’une entreprise sur trois en France (36%) a pleinement intégré la diversité dans ses pratiques de recrutement. Un progrès, certes… mais encore insuffisant.
Parmi les principaux freins à une inclusion plus large des personnes marginalisées : les biais de recrutement, des mécanismes mentaux qui vous empêchent de juger les candidats de manière objective. De quoi s’agit-il ? Quels sont les principaux biais cognitifs dans le recrutement ? Et comment ne pas tomber dans le piège ?
Qu’est-ce qu’un biais cognitif ?
Les biais cognitifs sont des mécanismes mentaux qui déforment la manière dont nous percevons la réalité. Ils agissent de manière inconsciente et nous poussent à faire des raccourcis. Appliqués au recrutement, ils obscurcissent nos jugements et introduisent une dose de subjectivité dans un processus qui devrait idéalement rester objectif et équitable.
Concrètement, cela peut se traduire par une préférence injustifiée pour certains candidats (parce qu’ils nous ressemblent, parce qu’ils viennent d’une école prestigieuse, ou encore parce qu’ils ont fait bonne impression dès les premières minutes), ou au contraire par une sous-évaluation d’autres profils pourtant compétents.
Ces distorsions mentales ne sont pas forcément intentionnelles, mais elles peuvent avoir un impact significatif sur la qualité des décisions prises, sur la diversité au sein des équipes, et sur l’équité perçue par les candidats. Par exemple, elles freinent l’inclusion des personnes neuratypiques, handicapées ou présentant des parcours atypiques, qui se voient souvent écartées non pas pour des raisons de compétences, mais à cause de jugements biaisés.
Les 6 biais principaux en recrutement
S’il en existe toute une palette qui régissent nos interactions sociales, voici les principaux biais qui peuvent vous faire passer à côté du meilleur candidat. Pire, vous pousser à recruter quelqu’un qui, en réalité, ne fait pas l’affaire.
Le biais de confirmation
C’est l’un des biais le plus commun au quotidien. Exemple : vous recevez en entretien une jeune femme diplômée de HEC Paris. Selon vous, tous les étudiants de cette école sont forcément brillants et performants. Dans son discours, plusieurs éléments confirment d’ailleurs votre pensée : elle a confiance en elle, ses propos sont clairs et cohérents. En clair : la candidate idéale.
En réalité, vous minimisez ou ignorez les signaux qui pourraient nuancer un jugement que vous aviez déjà formé avant même qu’elle n’ouvre la bouche : un manque d’expérience concrète, des compétences techniques vacillantes…
En d’autres termes, votre cerveau a été victime du biais de confirmation : il a choisi de sélectionner et de mettre en avant les informations qui confirment votre opinion initiale, et de laisser de côté tout ce qui était susceptible de la remettre en cause.
Le biais d’affinité
“Qui se ressemble s’assemble”. Si cet adage résonne aussi fort, c’est parce qu’il est lié à un biais d’affinité. Inconsciemment, nous avons tendance à aller vers les personnes qui nous ressemblent – que ce soit au niveau du physique, du parcours, des valeurs…
Il n’est donc pas difficile d’imaginer quelles dérives peuvent découler de ce biais cognitif en recrutement… Manque de diversité, d’inclusion, voire stéréotypes : autant d’éléments qui impactent votre entreprise sur le long-terme.
Car l’effet de clonage tend à instaurer un statu quo, tandis que la diversité, à contrario, permet de maximiser l’intelligence collective et d’apporter du renouveau. Une qualité essentielle pour une entreprise qui cherche à se réinventer en permanence et à naviguer dans un contexte socio-économique en pleine mutation.
L’effet de halo
“La première impression est toujours la bonne”. Vraiment ? Car, à en croire l’effet de halo, il semblerait qu’elle nous induise en fait en erreur. Comme pour le biais de confirmation, tout est une affaire de perception. Si vous percevez un homme bien habillé et que vous en déduisez qu’il est nécessairement compétent, alors qu’au contraire, un autre candidat qui vous semble plus négligé vous renvoie l’image de quelqu’un d’incompétent, alors vous êtes victime de l’effet de halo.
En clair, la première impression que vous vous faites sur une personne va conditionner votre jugement sur l’ensemble de ses actions ensuite. La poignée de mains incarne bien ce biais cognitif : un geste ferme et assuré donnera l’impression de confiance et de professionnalisme, tandis qu’une poignée de main molle ou hésitante pourra, à tort, être associée à de la faiblesse ou un manque de fiabilité.
L’effet Dunning-Kruger
Popularisé auprès du grand public, ce biais agit insidieusement dans le recrutement, amenant les recruteurs à faire des erreurs de casting. Le principe : certaines personnes, peu compétentes sur un sujet, tendent à surestimer leurs capacités, convaincues de maîtriser des notions qu’elles connaissent en réalité très mal. À l’inverse, d’autres, réellement compétentes, ont tendance à sous-estimer leur niveau, pensant que ce qu’elles savent est “évident” pour tout le monde.
Ce paradoxe s’explique par le fait que le manque de connaissances empêche d’évaluer correctement sa propre performance : on ne sait pas ce que l’on ne sait pas. À l’opposé, les experts, conscients de la complexité d’un domaine, mesurent mieux l’étendue de ce qu’ils ignorent et adoptent une posture plus prudente. En contexte de recrutement, ce biais est redoutable et peut fausser l’évaluation : un candidat très sûr de lui peut séduire un recruteur par son assurance, alors même qu’il n’a pas les compétences requises. À l’inverse, un profil compétent mais plus réservé peut être sous-évalué.
L’effet de primauté / récence
Premier arrivé, premier servi. Derrière ce diction se cache une réalité : nous tendons à nous souvenir davantage des premiers et des derniers candidats reçus en entretien. Les premiers, eux, sont ceux qui donnent le ton et font une première impression – c’est l’effet de primauté. Quant aux derniers candidats, ils resteront plus frais dans votre mémoire, bénéficiant de l’effet de récence. En d’autres termes, vous considérerez d’avantage ces candidats-là, oubliant parfois ceux que vous avez reçus en entretien entre les deux.
Le biais d’extraordinarité
Dans un processus de recrutement, il arrive qu’un élément atypique ou marquant attire toute l’attention – un parcours insolite, une expérience dans une entreprise prestigieuse, une compétence rare, voire un détail surprenant du CV.
Ce phénomène est le biais d’extraordinarité : notre esprit accorde une importance disproportionnée à une caractéristique “hors du commun”, au détriment de l’ensemble du profil.
Par exemple, un candidat qui a travaillé dans une grande ONG internationale pourra impressionner et être perçu comme “exceptionnel”, même si ses compétences techniques ne correspondent pas vraiment au poste. À l’inverse, un parcours jugé plus classique risque d’être sous-évalué, même si les qualifications sont parfaitement alignées avec les besoins de l’entreprise.
Nos conseils pour limiter l’impact des biais de recrutement
Si tous ces biais cognitifs se jouent dans l’inconscient, comment peut-on agir dessus ? Pouvons-nous reprendre le contrôle à 100% ? Pas évident de répondre un franc “oui”, car nos cerveaux restent influencés par des automatismes très profonds. En revanche, il est tout à fait possible de réduire leur impact et de créer un processus de recrutement plus juste et plus objectif.
Standardiser les processus de recrutement
Veillez autant que possible à ce que les processus de recrutement soient les mêmes pour tout le monde : mêmes conditions d’entretien, même évaluation, même traitement. Si vous avez décidé de limiter l’entretien d’embauche à 45 minutes, alors la règle doit s’appliquer à tous les candidats.
En clair, en établissant un processus de recrutement clair et réfléchi en amont, vous limitez les biais cognitifs qui pourraient influencer votre décision.
Se munir d’une grille d’évaluation
Plutôt que de juger un candidat aléatoirement sur des critères subjectifs, prévoyez une grille d’évaluation définie en amont, qui sera votre boussole lors des entretiens d’embauche. Compétences recherchées, soft skills requises, niveau d’expérience obligatoire : autant d’éléments qui garantissent l’adéquation d’une personne à un poste précis. Ce faisant, vous vous référez à des critères objectifs, et non liés à votre perception ou votre ressenti.
Garder une trace écrite
La mémoire est faillible… et influencée par les biais ! Pour réduire leur poids, il est essentiel de prendre des notes pendant ou immédiatement après l’entretien. Cela permet de baser l’évaluation sur des faits concrets, et non sur des impressions fugitives. Ces traces écrites vous aideront aussi à justifier vos décisions auprès de vos collaborateurs, voire des candidats eux-mêmes si nécessaire.
Multiplier les avis
Le recrutement ne devrait pas reposer sur le jugement d’une seule personne. Multiplier les entretiens, en impliquant plusieurs évaluateurs aux profils et sensibilités différents, permet de diversifier les points de vue et d’atténuer l’impact des biais individuels. En confrontant les retours, vous aurez une vision plus équilibrée du candidat et limiterez les erreurs de jugement.
Quid du “feeling” en entretien d’embauche ?
Vous avez déjà entendu cette fameuse phrase : “J*’ai eu un bon feeling avec lui*”. Bien que l’intuition joue un rôle important dans le recrutement, elle ne peut décemment constituer le critère principal d’une embauche. D’autant plus quand ce “feeling” est conditionné par des biais cognitifs que nous ne maîtrisons pas.
C’est pourquoi il est indispensable, en tant que recruteur, de séparer :
- L’intuition : ce ressenti immédiat, souvent influencé par les biais cognitifs, qui peut donner une impression positive ou négative mais qui reste subjectif.
- Le rationnel : l’évaluation basée sur des critères objectifs, définis à l’avance, mesurables et comparables entre candidats.
En d’autres termes, le “feeling” peut être un signal à prendre en compte, mais il ne doit jamais prendre le pas sur une analyse structurée et argumentée. La clé est donc d’apprendre à écouter son intuition… sans la laisser guider seule la décision finale.