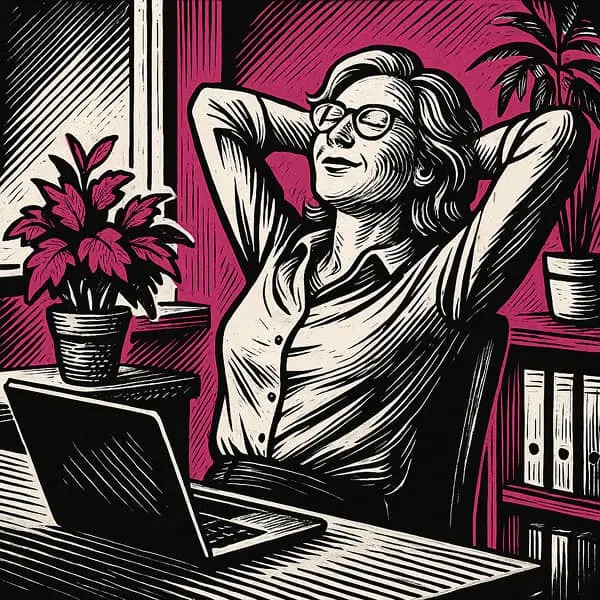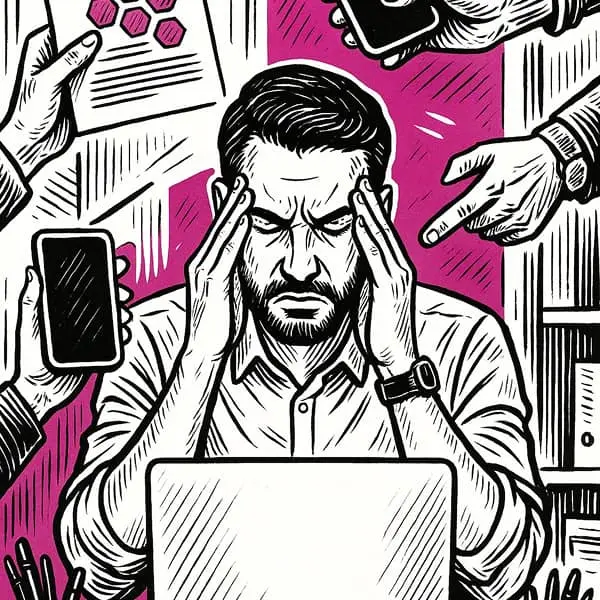Plus d’une femme active sur deux se déclare inquiète pour sa santé physique et mentale. C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par Vérian pour le Laboratoire de l’Égalité. Un phénomène qui tend à se généraliser depuis plusieurs années, mais qui reste pourtant peu médiatisé.
Burn out, accidents du travail, troubles psychiques : à l’occasion d’octobre rose, qui sensibilise les femmes au dépistage du cancer du sein, on a décidé de mettre en lumière un sujet trop souvent relégué au second plan : la santé féminine. Décryptage.
Les chiffres alarmants sur la santé des salariées françaises…
Les études sur la santé des femmes sont peu nombreuses, ou bien ne font pas l’objet d’une analyse ciblée. Elles sont généralement incluses dans des échantillons mixtes, qui ne permettent pas d’appréhender avec précision les problématiques qui leur sont propres.
Et pourtant, il suffit de jeter un œil aux (trop) rares rapports sur la santé des salariées françaises pour dresser un constat préoccupant :
- Les femmes sont trois fois plus nombreuses à faire état de troubles psychiques liés au travail que les hommes.
- Elles sont les premières victimes de troubles musculosquelettiques (source : Rapport du Sénat).
- On constate une surreprésentation des femmes dans des secteurs plus pénibles physiquement et psychologiquement.
- Le nombre d’accidents du travail explose chez les femmes depuis 20 ans.
À la lumière de ces chiffres, comment expliquer une telle explosion des troubles psychiques chez les femmes actives ? Quels mécanismes invisibles usent les femmes au travail jusqu’à l’épuisement ?
Et surtout : pourquoi ce sujet reste-t-il marginal dans le débat public, alors qu’il touche des millions de vies ?
Santé au travail : pourquoi les femmes sont-elles encore exclues du débat ?
Un monde du travail conçu par et pour les hommes
Pour comprendre pourquoi la santé au travail reste si peu adaptée aux femmes, il faut regarder dans le rétroviseur. Loin derrière.
Du XVIIème au XIXème siècle, la société repose sur une vision très claire : celle des deux sphères. L’espace public appartient aux hommes. L’espace privé, aux femmes.
Et si, en 1791, Olympe de Gouges proclame haut et fort : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits”,dans les faits, l’égalité attendra. Longtemps.
Elle attendra :
- 1907 pour qu’elles obtiennent le droit à disposer d’un salaire.
- 1919 pour qu’elles puissent passer le baccalauréat.
- 1965 pour obtenir l’indépendance financière.
- Puis 1972 pour voir apparaître la première loi sur l’égalité salariale.
Une entrée tardive dans le monde professionnel, qui laisse encore aujourd’hui des traces profondes, et toujours marquées au fer rouge par les inégalités.
Ce voyage éclair dans le temps est nécessaire pour comprendre pourquoi les politiques RH et managériales des entreprises ont été bâties sur un modèle masculin, ancrées dans des millénaires de pratiques. Le tout, en oubliant les spécificités biologiques – sujets à débat -, psychologiques et sociales des femmes.
Un enjeu clé : l’équilibre vie pro / vie perso
D’après l’étude Vérian menée pour le Laboratoire de l’Égalité, un quart des femmes actives citent spontanément l’équilibre entre vie pro et vie perso comme l’un des facteurs ayant le plus d’impact sur leur santé.
En cause : une charge mentale qui reste encore forte dans la sphère familiale, couplée à celle d’une sphère professionnelle encore largement inégalitaire. Selon un baromètre réalisé par News RSE avec l’Ifop, 66% des femmes déclarent que leur charge mentale professionnelle a un impact sur leur vie personnelle, et 53% déclarent que la charge mentale personnelle du quotidien a un impact sur leur vie professionnelle.
Une véritable dualité, qu’on peut qualifier trivialement de serpent qui se mord la queue. Car si les femmes effectuent encore 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales selon l’INSEE, il faut désormais y ajouter une semaine à 35h, ponctuée de réunions, de sollicitations constantes, d’injonctions à la performance… et souvent, d’un manque criant de reconnaissance.
Face à ces constats, une question s’impose : comment tenir dans la durée quand la théorie millénaire des deux sphères s’est désormais muée en “double shift” chez la plupart des femmes actives ? Qu’elles occupent maintenant la sphère publique ET privée ? Un exercice d’équilibriste qui, visiblement, nuirait à leur santé sur le long-terme.
Un manque de connaissance médicales sur la santé féminine
Aux racines de l’exclusion de la santé féminine dans le débat sur la santé au travail figure également une autre réalité : l’invisibilisation historique des douleurs et des symptômes spécifiquement féminins, souvent minimisés, ignorés ou mal compris par les systèmes médicaux… et donc managériaux.
La preuve : 4 femmes sur 10 ont déjà eu le sentiment de ne pas être écoutées et que leurs symptômes étaient minimisés lors d’une consultation médicale (Source : Baromètre Agir pour le coeur des femmes / OpinionWay).
Dans leur ouvrage Femmes et santé, encore une affaire d’hommes, Muriel Salle et Catherine Vidal dissèquent comment la médecine traite les femmes depuis l’Antiquité, du “sexe faible” aux “éternelles malades”, mettant en lumière une médecine construite par et pour les hommes, où le corps féminin est souvent perçu comme une déviation du corps masculin, et donc moins légitime à être étudié, compris… ou simplement cru.
Cette culture du doute s’est infiltrée dans le monde du travail : douleurs menstruelles jugées anecdotiques, endométriose passée sous silence, ménopause perçue comme un sujet tabou… Résultat : des femmes contraintes de taire leur inconfort pour rester “professionnelles”, de peur d’être perçues comme fragiles ou moins performantes.
Un biais qui continue d’influencer – pour ne pas dire empoisonner – les politiques RH, les normes d’aménagement du travail et même les pratiques de prévention.
Des priorités RH axées sur d’autres enjeux
Mais que font les RH, qui sont pourtant aujourd’hui considérés en partie comme les garants du bien-être en entreprise ? Et à fortiori, que font les femmes RH, qui représentent près de 87% de la profession selon une étude réalisée par Culture RH en 2024 ?
La réponse à cette question est ancrée dans des mécanismes systémiques profondément enracinés. Elles-mêmes soumises aux mêmes problématiques que leurs congénères féminines, elles doivent répondre à des priorités RH axées sur d’autres enjeux : focalisation sur la performance, prévention de risques généraux…
Résultat : les salariées ressentent un véritable manque d’écoute et de compréhension dans le milieu professionnel. Selon l’enquête menée par BVA Xsight, seulement 6% d’entre elles se déclarent à l’aise pour parler de leur santé à leur employeur avec comme justification la peur d’être jugées, le sentiment qu’il s’agit là d’une thématique trop intime, voire la honte.
Pire : 73% pensent que les jours d’arrêt de travail pour troubles féminins les pénalisent au travail. Un avis que partagent malheureusement les employeurs, qui sont à 68% d’accord avec cette opinion.
Ce décalage est renforcé par un manque criant de sensibilisation des décideurs RH :
- Méconnaissance des maladies féminines en entreprise (endométriose, ménopause, troubles menstruels…) alors qu’elles concernent des millions de salariées.
- Stéréotypes persistants autour de la “fragilité” des femmes, du rôle de mère ou encore de leur supposée moindre disponibilité.
- Absence de dispositifs adaptés et de formations pour outiller les managers et accompagner ces réalités.
En bref, ce silence n’est pas le fruit d’un désintérêt volontaire, mais bien d’un angle mort culturel et organisationnel qui maintient ces sujets en marge du dialogue social.
Un silence sur la santé féminine qui pénalise les salariées françaises
Outre la multiplication des accidents du travail, des burn outs, et des risques psycho-sociaux (RPS), l’invisibilisation de la santé féminine dans les politiques RH se paie au prix fort. Pour les salariées, mais pas que…
Car si les femmes actives se heurtent déjà au plafond de verre – souvent renforcé par la question de la maternité – l’absence de prise en compte de leur santé (cycles, endométriose, ménopause…) freine leur ascension, accentue les inégalités salariales… et prive les organisations d’un formidable vivier de talents.
Ignorer la santé féminine et refuser de la prendre en comte, c’est :
- une baisse de productivité et d’engagement,
- une hausse de l’absentéisme,
- et une perte de fidélisation des collaboratrices les plus qualifiées.
À l’inverse, intégrer ces enjeux dans la politique RH, c’est investir dans la performance durable : attirer, retenir et faire grandir les talents féminins, renforcer la marque employeur et créer une culture plus inclusive.
Les entreprises qui auront compris cela prendront une longueur d’avance. Les autres continueront à payer la facture – humaine et économique.
Mettre la santé des femmes au travail au premier plan
Mais comment inverser la tendance ? Comment mettre sur le devant de la scène la santé féminine, elle qui a toujours été reléguée au second plan, cachée – par honte, par tabou, par ignorance ? Aujourd’hui, 2/3 des femmes en activité considèrent que l’employeur a un rôle à jouer en matière de prévention de la santé des femmes (Source : Baromètre Agir pour le coeur des femmes / OpinionWay. La preuve que le changement doit venir d’en haut.
Sensibiliser l’entreprise sur la santé des femmes
La première étape consiste à lever le voile, à briser le tabou. Tant que la santé des femmes restera enfermée dans le silence, elle restera marginalisée. Il ne s’agit pas seulement d’une question médicale : c’est un sujet culturel, organisationnel et politique.
Parler ouvertement des cycles menstruels, de l’endométriose, de la ménopause ou encore des spécificités cardiovasculaires féminines, c’est déjà reconnaître leur existence. C’est aussi mettre fin à des décennies de déni, où le corps masculin a servi de norme universelle pour la recherche médicale, les politiques de prévention… et les pratiques RH.
Encourager le dialogue ouvert et continu
Sensibiliser passe d’abord par la parole. Les entreprises doivent créer les conditions d’un dialogue authentique et sans tabou, en permettant aux collaboratrices de s’exprimer sur leurs réalités de santé sans crainte d’être jugées. Mettre en place des espaces de confiance, identifier des personnes référentes ou encore faire intervenir des experts externes sont autant de leviers pour libérer la parole.
Former les acteurs RH et les managers
La sensibilisation ne peut être efficace que si elle est accompagnée d’une montée en compétence. Former les acteurs RH, mais aussi l’ensemble des managers, est indispensable pour reconnaître les besoins spécifiques liés à la santé féminine et savoir y répondre avec justesse.
Il s’agit de donner des clés de compréhension, de déconstruire les stéréotypes persistants et d’apporter des solutions concrètes. Cette formation doit devenir un réflexe intégré dans les parcours de développement managérial et non une option périphérique.
Adapter les dispositifs RH et les conditions de travail
Enfin, sensibiliser sans transformer les pratiques serait vain. Les entreprises doivent adapter leurs dispositifs RH aux réalités vécues par leurs salariées. Cela peut passer par davantage de flexibilité dans l’organisation du travail, la possibilité d’aménagements spécifiques pour les collaboratrices atteintes de pathologies comme l’endométriose, ou encore une meilleure répartition des congés liés à la parentalité.
Certaines organisations explorent déjà des solutions plus audacieuses, comme la semaine de 4 jours ou la mise en place de dispositifs spécifiques durant la semaine de la QVT. Ces initiatives, au-delà du symbole, envoient un signal fort : reconnaître que la performance durable passe par la santé, l’équilibre et le bien-être de toutes et tous.
L’objectif : instaurer des conditions de travail réellement équitables, qui permettent à chacune de concilier santé, performance et épanouissement professionnel. Et faire de ce sujet un axe à part entière de la QVT en entreprise.
Des pratiques inspirantes pour mieux prendre soin des femmes au travail
L’Oréal
Depuis 2013, L’Oréal déploie dans plus de 70 pays le programme Share & Care, qui regroupe ses engagements en matière de santé, protection sociale, équilibre vie professionnelle/vie personnelle et bien-être.
Concrètement, ce dispositif se traduit par un accès renforcé à la prévention et au dépistage, avec des campagnes régulières (comme Octobre Rose) pour encourager les salariées à prendre soin de leur santé.
L’entreprise va également au-delà des obligations légales en matière de parentalité : au minimum 14 semaines de congés rémunérés pour le parent principal et 6 semaines pour l’autre parent, complétés en France par le “congé Schueller” (4 semaines supplémentaires après une maternité ou une adoption). Aux États-Unis, un “Family Building Leave” a même été créé pour accompagner les projets d’adoption ou de gestation pour autrui.
Avec ces initiatives, L’Oréal envoie un signal clair : considérer la santé féminine ne relève pas du bonus social, mais d’une politique RH ambitieuse, pensée pour durer et adaptée aux réalités de terrain.
Carrefour
En 2023, Carrefour a marqué un tournant dans le paysage social français en devenant l’une des premières grandes entreprises à reconnaître l’impact de l’endométriose sur la vie professionnelle. L’enseigne a mis en place un dispositif inédit : jusqu’à 12 jours de congés par an pour les collaboratrices concernées.
Derrière cette mesure, il y a un double message : lever le tabou autour d’une maladie chronique qui touche une femme sur dix, et envoyer un signal fort en matière de qualité de vie au travail.
Au-delà de l’aspect RH, Carrefour a ouvert un débat public sur la manière dont les organisations peuvent adapter leurs pratiques aux réalités de santé spécifiques aux femmes. Un pas encore isolé en France, mais qui illustre une prise de conscience progressive : prendre soin de la santé féminine, c’est aussi investir dans l’engagement, la fidélisation et la performance des équipes.