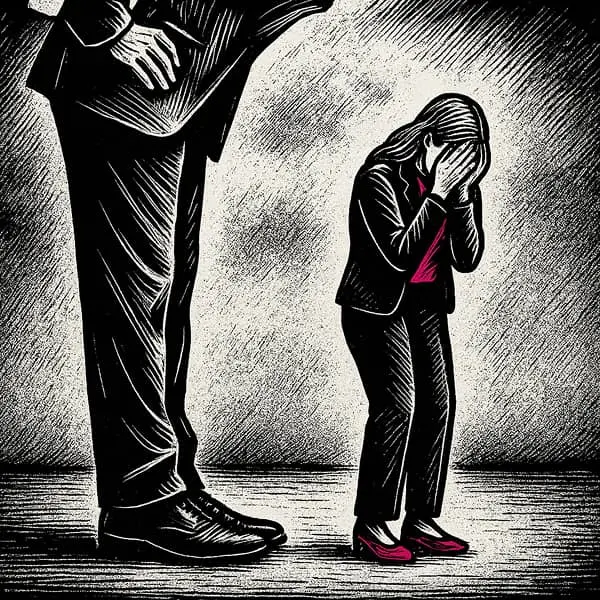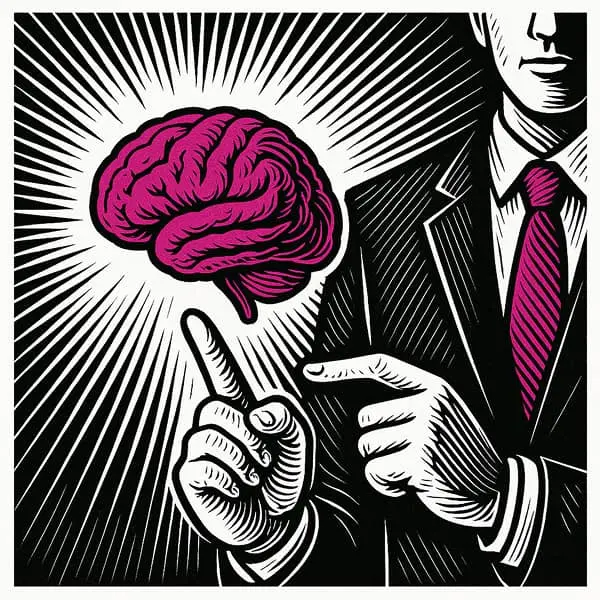Les entreprises françaises se disent toujours plus responsables, mais les salariés, eux, peinent à y croire. Selon une étude SD Worx menée dans 16 pays européens, un fossé se creuse entre la communication RSE des employeurs et la réalité perçue sur le terrain. Un écart qui interroge à l’heure de la mise en œuvre de la directive européenne CSRD.
La RSE sous pression : entre exigences réglementaires et image de marque
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) n’est plus un simple argument d’image : elle est devenue une obligation stratégique.
Et pour cause, depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne CSRD, les grandes entreprises doivent désormais publier des informations détaillées sur leurs politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette réglementation, pensée pour renforcer la transparence et lutter contre le “greenwashing”, pousse les organisations à formaliser et à valoriser leurs engagements RSE.
En France comme en Europe, la pression s’accentue. Les groupes déjà concernés ont dû revoir leurs pratiques de reporting, tandis que les PME se préparent à leur tour à se conformer aux nouvelles exigences d’ici quelques années. Résultat : la communication RSE s’intensifie, portée à la fois par un impératif réglementaire et une volonté de soigner leur réputation d’entreprise responsable.
Mais si les discours se multiplient, la perception interne peine à suivre. Entre obligations de transparence, enjeux d’image employeur et réalité vécue sur le terrain, un décalage s’installe.
Des entreprises convaincues de leurs efforts… mais des salariés sceptiques
Du côté des dirigeants, la confiance est au beau fixe. D’après l’étude menée par SD Worx, 72 % des entreprises françaises estiment que leur communication en matière de RSE est crédible et reflète fidèlement leurs actions. Mieux encore, plus d’une entreprise sur deux affirme intégrer aujourd’hui les enjeux sociaux et environnementaux à sa stratégie RH.
Mais cette perception ne trouve pas toujours d’écho en interne. La preuve : seuls 50 % des salariés déclarent faire confiance aux efforts de leur employeur en matière de développement durable ou d’engagement sociétal.
L’écart est significatif, et il se creuse particulièrement en France, où il atteint l’un des plus hauts niveaux d’Europe. En effet, si 74 % des entreprises françaises affirment vouloir valoriser leurs ambitions en matière de RSE, seulement un salarié sur deux juge la démarche de son employeur réellement engageante.
Chez nos voisins, le constat varie. Les activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) occupent une place croissante dans l’agenda RH partout en Europe. Ce sujet est prépondérant au Royaume-Uni et en Irlande (68 % chacun), ainsi qu’en Roumanie (65 %), tandis qu’en Allemagne et en Belgique (47 %), les entreprises affichent un intérêt moindre pour la RSE.
Pourquoi le décalage persiste ?
Comment expliquer un tel fossé entre la perception des entreprises et celles des collaborateurs ?
Derrière ce manque de confiance se cache une réalité complexe. La RSE, souvent pilotée au niveau stratégique ou institutionnel, reste trop éloignée de l’expérience quotidienne des collaborateurs. Les actions concrètes (tri des déchets, partenariats solidaires, inclusion, mobilité douce…) peinent à être perçues comme une véritable transformation du travail.
Une communication descendante
De nombreuses entreprises communiquent largement sur leurs engagements, mais de manière verticale, via des communiqués, rapports ou campagnes internes peu incarnées. Via ces messages qui manquent de proximité et d’impact, les salariés ont donc parfois l’impression que la RSE “se raconte” plus qu’elle ne “se vit”.
Un manque de cohérence
Les initiatives RSE peuvent sembler déconnectées du quotidien professionnel. Comment parler d’inclusion si les pratiques managériales ne suivent pas ? Comment valoriser la sobriété énergétique quand les outils ou process internes ne changent pas ? Cette dissonance entre discours et actions mine la crédibilité du message.
L’absence de mesure et de partage d’impact
Les indicateurs existent, mais restent souvent techniques ou confidentiels. Les salariés, eux, ont besoin de voir concrètement les effets des actions engagées : une baisse réelle de la consommation, des partenariats durables, des avancées sur la qualité de vie au travail… Sans preuve tangible, la RSE demeure un concept flou.
Pour combler ce fossé, la clé réside dans une communication plus transparente, participative et incarnée. Impliquer les collaborateurs dans les projets RSE, valoriser leurs initiatives, et rendre visibles les résultats permet de transformer la confiance en engagement.
RSE : sans confiance, pas d’engagement durable
Pourquoi le fossé entre la perception des salariés et des entreprises en matière de RSE est-il si préoccupant ? Parce que la confiance est le carburant d’une politique RSE qui change vraiment les choses. Quand les salariés perçoivent les engagements comme authentiques et crédibles, tout s’aligne :
- Ils sont 12 % plus enclins à juger l’entreprise attractive ;
- Leur satisfaction au travail progresse de 8 à 10 %, leur motivation et leur engagement montent ;
- L’intention de départ recule de 2 à 2,5 %.
À l’inverse, un grand écart entre slogans et réalité créé du scepticisme et freine la transformation. Bâtir la confiance, c’est donc prouver, mesurer, expliquer, et embarquer les équipes dans l’action, pas seulement dans la communication.
Autrement dit : pas de RSE crédible sans cohérence ni transparence. Et pas d’impact durable sans une confiance qui se voit, se vit et se compte.