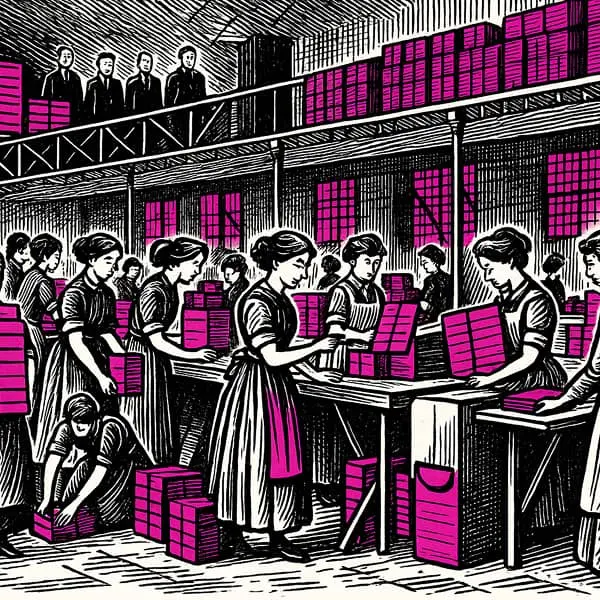Qui ne s’est jamais plaint de CE collègue qui a visiblement un excès de confiance en lui et passe son temps à vanter ses connaissances, alors même qu’il vous paraît tout bonnement incompétent ?
Non, vous n’êtes pas mauvais, car ce phénomène a un nom : l’effet Dunning-Kruger. Et ses effets peuvent être dévastateurs en entreprise. Focus sur ce biais cognitif qui pousse les moins compétents à se surestimer… et les plus compétents à douter d’eux-mêmes.
Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ?
Un biais cognitif
Dans la famille des biais cognitifs, nous demandons l’effet Dunning-Kruger. On doit ce concept aux psychologues David Dunning et Justin Kruger, qui l’ont mis en évidence en 1999. Il caractérise les personnes les moins compétentes qui ont tendance à se surestimer. En d’autres termes, plus une personne serait compétente, plus elle tendrait à douter de ses capacités.
Aussi appelé biais de surconfiance, il s’agit en fait d’une distorsion de la manière dont nous nous percevons.
La fameuse courbe de l’effet Dunning-Kruger illustre visuellement ce paradoxe entre compétence réelle et confiance perçue. Elle se déroule en plusieurs phases bien distinctes :
- Le “Mont de la stupidité” (ou Mont de la confiance excessive)
- Au départ, lorsqu’une personne découvre un sujet et acquiert quelques notions, sa confiance grimpe en flèche.
- Elle a l’illusion de “tout comprendre”, alors que ses compétences réelles restent très limitées.
- C’est le collègue qui, après avoir lu un article ou suivi une formation de deux heures, se pense expert.
- La “Vallée de l’humilité” (ou gouffre de désillusion)
- Avec un peu plus d’expérience, la personne se rend compte de la complexité du sujet.
- Sa confiance s’effondre : elle prend conscience de tout ce qu’elle ignore.
- C’est souvent le moment où l’on se sent dépassé et peu légitime.
- La “Pente de l’illumination”
- En poursuivant son apprentissage, la compétence augmente réellement.
- La confiance remonte progressivement, cette fois de façon plus réaliste et proportionnelle au savoir acquis.
- Le “Plateau de la consolidation”
- Avec une expertise solide, la confiance devient stable et mesurée.
- L’expert sait qu’il maîtrise son sujet… mais garde une certaine humilité, car il perçoit aussi les limites de ses connaissances.
En résumé : les moins compétents se croient souvent meilleurs qu’ils ne le sont, tandis que les plus compétents sont parfois rongés par le doute. Cette distorsion explique pourquoi, en entreprise, certains profils bruyants paraissent “brillants” alors que de vrais experts hésitent à se mettre en avant.
L’histoire derrière l’effet Dunning-Kruger
Les deux psychologues à l’origine de l’effet Dunning-Kruger se sont intéressés au concept suite à un fait divers. En 1995, McArthur Wheeler braque deux banques en plein jour, le visage découvert et enduit de jus de citron – persuadé que ce dernier le rendrait invisible aux caméras (puisque le jus de citron peut servir d’encre invisible).
Une surconfiance un peu absurde, qui pousse Dunning et Kruger à s’interroger : comment un individu peut-il être si certain d’avoir raison, alors qu’il se trompe de manière flagrante ? Leur intuition est confirmée par une série d’expériences : les participants les moins performants sont aussi ceux qui s’évaluent le mieux… à leurs propres yeux. Non seulement ils échouent, mais ils manquent aussi des compétences nécessaires pour reconnaître leur propre incompétence.
Comment se manifeste l’effet Dunning-Kruger en entreprise ?
S’il agit sur tous les plans de notre vie, l’effet Dunning-Kruger se manifeste également dans le monde professionnel – et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Quelques signes majeurs :
-
Mauvaise évaluation lors du recrutement :
Les candidats atteints de surconfiance ont souvent un discours très convaincant en entretien. Ils se présentent comme experts, enjolivent leurs compétences et paraissent sûrs d’eux. À l’inverse, les candidats réellement compétents peuvent minimiser leur savoir-faire, par humilité. Résultat : certaines entreprises passent à côté de profils qualifiés, au profit de candidats beaucoup moins compétents – mais qui font plus de bruit.
-
Surévaluation de ses compétences :
Ces profils se lancent volontiers dans des projets ou des missions au-delà de leurs capacités réelles. Ils promettent plus qu’ils ne peuvent tenir, persuadés qu’ils maîtrisent déjà le sujet. Cela mène à des erreurs coûteuses, des délais non respectés ou encore des livrables de mauvaise qualité.
-
Difficulté à se remettre en question :
Puisque leur confiance repose sur l’illusion de compétence, ces personnes ont du mal à accepter la critique. Elles perçoivent souvent les feedbacks comme injustes ou infondés. Ce manque de remise en question freine leur progression… et complique la collaboration avec leurs collègues.
-
Dégradation de l’ambiance au sein d’une équipe :
Un collaborateur trop sûr de lui, mais objectivement incompétent, peut vite créer des tensions. Il monopolise la parole, minimise les autres, et génère frustration et démotivation chez ses pairs plus compétents mais moins bruyants. L’équilibre d’une équipe peut s’en trouver perturbé.
-
Retombées sur les relations avec les clients / prestataires :
Lorsqu’un collaborateur se présente comme expert alors qu’il ne l’est pas, il met directement en péril l’image et la crédibilité de l’entreprise. Les promesses non tenues, les erreurs techniques ou les explications hasardeuses face aux clients peuvent nuire durablement à la confiance accordée à l’organisation.
Quelles solutions pour remédier à l’effet Dunnin-Kruger ?
Difficile de lutter contre un biais cognitif qui agit au niveau de l’inconscient… Mais pas impossible ! En prenant conscience de l’effet Dunning-Kruger, les servies RH et managers peuvent adopter plusieurs stratégies pour le limiter.
Mettre au point des processus de recrutement plus objectifs
Pas question de laisser le hasard – ou l’intuition – décider des choses ! Pour éviter les erreurs de casting et vous assurer de recruter les bonnes personnes, établissez un processus de recrutement qui se veut aussi précis que possible. Définissez une fiche de poste claire en amont, une grille d’évaluation avec des critères, et des méthodes d’évaluation adaptées.
Veillez également à standardiser les entretiens pour que chaque candidat soit jugé sur les mêmes éléments. Cela peut passer par des mises en situation concrètes, des tests techniques ou encore des études de cas permettant de mesurer objectivement les compétences. Enfin, impliquez plusieurs interlocuteurs dans le processus afin de croiser les points de vue et réduire le poids des biais individuels.
Un recrutement objectif ne signifie pas froid ou impersonnel : il s’agit simplement de mettre en place un cadre structuré qui donne toutes ses chances au candidat… et à l’entreprise de faire le bon choix.
Instaurer un feedback régulier
Le feedback est l’un des leviers les plus efficaces pour limiter l’effet Dunning-Kruger. En donnant à chacun un retour objectif et fréquent sur ses performances, on l’aide à ajuster la perception qu’il a de ses compétences.
Cela peut passer par :
- Des points réguliers en one-to-one entre manager et collaborateur pour aborder les réussites, les axes d’amélioration et les prochaines étapes.
- Le feedback 360°, qui inclut l’évaluation des pairs, des subordonnés et du manager. Ce système met en lumière les écarts de perception et apporte un regard plus complet.
- Un feedback immédiat et constructif lors de projets ou de livrables : au lieu d’attendre un entretien annuel, corriger (ou valoriser) en temps réel permet de progresser plus vite.
L’objectif n’est pas de critiquer mais de recadrer les perceptions : aider ceux qui se surestiment à prendre conscience de leurs limites, et encourager ceux qui doutent à reconnaître leurs véritables forces.
Définir des objectifs clairs et partagés
Les collaborateurs qui se surestiment ont souvent une vision floue de leurs responsabilités ou de la valeur réelle de leurs actions. Pour réduire cet écart entre perception et réalité, il est essentiel de définir des objectifs précis.
- Utiliser la méthode SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) pour cadrer les missions.
- Formaliser des critères d’évaluation objectifs afin que chacun sache comment sera mesurée sa performance.
- Partager les objectifs au niveau collectif, pour favoriser la transparence et la comparaison constructive.
Cette démarche permet de responsabiliser les collaborateurs et de les aider à évaluer leurs progrès de manière factuelle, plutôt que sur un ressenti biaisé.
Proposer des formations pour développer ses compétences
L’une des meilleures façons de lutter contre l’illusion de compétence est d’encourager l’apprentissage continu grâce au plan de développement des compétences. La formation permet à la fois de renforcer le niveau réel des collaborateurs et de développer leur humilité en découvrant l’étendue d’un domaine.
- Formations techniques pour acquérir de véritables compétences dans son métier.
- Formations transverses (soft skills, communication, gestion de projet) qui aident à mieux travailler en équipe et à prendre du recul sur sa pratique.
- Apprentissage par la pratique via le mentorat, les ateliers collaboratifs ou les projets pilotes encadrés.
Plus un collaborateur apprend, plus il comprend la complexité d’un sujet, ce qui l’aide à trouver le juste équilibre entre confiance et lucidité.
L’effet Dunning-Kruger n’est pas seulement une curiosité psychologique : c’est un véritable enjeu pour les entreprises. Il peut fausser le recrutement, entraver la performance collective et créer des tensions au sein des équipes. Mais il n’est pas une fatalité.
En adoptant des processus d’évaluation objectifs, en instaurant une culture du feedback, en clarifiant les objectifs et en encourageant la formation continue, les organisations peuvent limiter ses impacts négatifs. Finalement, reconnaître ce biais cognitif, c’est déjà faire un pas vers plus de lucidité, d’humilité et d’efficacité – tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise dans son ensemble.