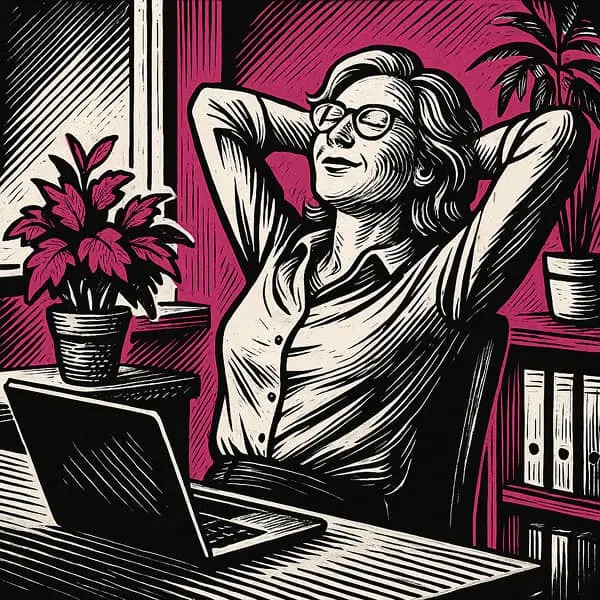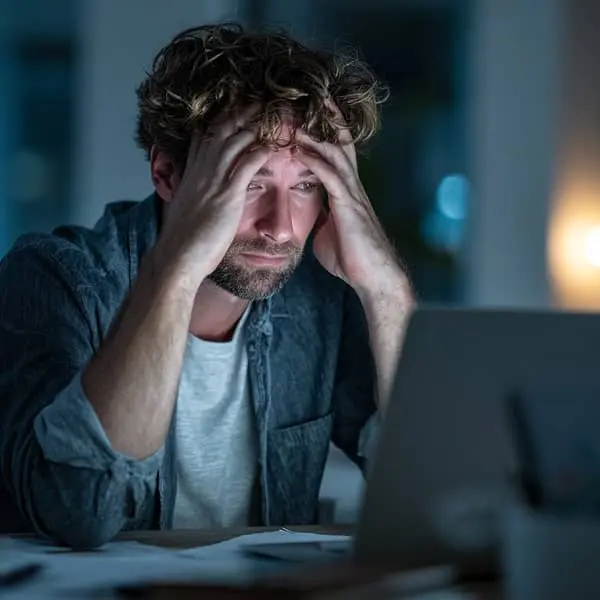1 salarié sur 4 est en situation de santé mentale dégradée selon un baromètre Qualisocial/ Ipsos publié en 2025. Une urgence qui incite RH et managers à ne plus détourner le regard, et se saisir du problème à bras le corps.
Entre prévention des risques psycho-sociaux, semaine de la QVCT, formations au management bienveillant ou encore dispositifs d’écoute psychologique, où en sont les entreprises en 2025 en matière de QVCT ? On fait le point dans cet article.
La QVCT, c’est quoi ?
Qualité de vie et des conditions de travail : derrière cette formule élargie, l’idée est simple mais ambitieuse. Il ne s’agit plus seulement de proposer un cadre de travail agréable, mais bien de repenser l’organisation du travail dans son ensemble, au service du bien-être et de l’efficacité.
Concrètement, la QVCT englobe un ensemble de leviers très opérationnels, qui, ensemble, façonnent le quotidien des collaborateurs.
Ce que recouvre la QVCT
- Le contenu et la qualité du travail : niveau d’autonomie, clarté des consignes, répartition de la charge, accès aux bons outils… autant de facteurs qui influencent directement la satisfaction au travail.
- Le développement des compétences : onboarding, entretiens annuels, formations, évolutions internes… La capacité à apprendre et progresser est un pilier de l’engagement.
- L’équilibre des temps de vie : télétravail, horaires souples, droit à la déconnexion, semaine de 4 jours… Autant de dispositifs qui aident à mieux articuler vies pro et perso.
- L’égalité et l’inclusion : parité, diversité, handicap, seniors… La QVCT prend aussi en compte la place et les besoins de chacun.
- L’environnement de travail : aménagement des postes, prévention des TMS, qualité de l’air, gestion des déplacements ou des nuisances sonores.
- Le climat social : qualité du dialogue entre équipes, posture managériale, rôle du CSE, reconnaissance au quotidien…
- La prévention des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, reste bien sûr un axe fondamental.
La QVCT, ce n’est donc ni une tendance, ni un simple levier d’attractivité. C’est une approche stratégique, structurée et continue, qui vise à rendre le travail plus soutenable, plus équitable, et plus porteur de sens pour toutes et tous.
Petit état des lieux de la QVCT en 2025
Quelques chiffres sur la santé mentale des salariés Français
- 25% des salariés estiment avoir une mauvaise santé mentale (source : baromètre Qualisocial/ Ipsos)
- 8 salariés sur 10 estiment que leur situation de détresse psychologique est liée au moins partiellement au travail (source : Baromètre Empreinte Humaine / OpinionWay)
- 54% des salariés estiment que le droit à la déconnexion est réellement appliqué dans leur entreprise
Les entreprises et la QVCT
La QVCT est un concept qui se fraie depuis plusieurs années un chemin dans le quotidien des collaborateurs français. Tant et si bien que 91% des salariés pensent que la QVCT est un élément prioritaire ou important à prendre en compte pour les employeurs (source : baromètre Qualisocial/ Ipsos).
Mais les entreprises sont-elles à jour ? Avec seulement 1 salarié sur 4 ayant accès à un plan de prévention complet en santé mentale au sein de son organisation, la QVCT ne semble pas encore au premier plan des préoccupations des employeurs.
Parmi les bons élèves, on retrouve le secteur des services aux entreprises, avec une QVCT globale supérieure de 5,6 % à la moyenne nationale, un engagement en hausse (+1,6 %) et une meilleure santé mentale perçue (+2,6 %).
Un engagement qui a des conséquences vertueuses, puisque les entreprise qui mettent un plan de prévention complet en santé mentale à disposition de leurs salariés ont noté :
- +30% des salariés en bonne santé mentale,
- 2,4x plus de capacité de concentration
- +39% d’engagement au travail
Ces chiffres mettent un véritable coup de projecteur sur la nécessité pour les entreprises de passer d’une posture déclarative à une démarche QVCT concrète et structurée.
QVT et QVCT : quelles différences ?
Il y a quelques années, on disait QVT. Mais depuis 2020, une lettre supplémentaire s’est glissée et on parle désormais de QVCT (qualité de vie et des conditions de travail). Un nouvel acronyme, créé dans le cadre de l’ANI sur la santé au travail du 9 décembre 2020, puis entériné par la loi du 2 août 2021 “pour renforcer la prévention en santé au travail”.
Derrière ce nouvel acronyme : une volonté de recentrer les entreprises sur “les conditions et le contenu du travail” plutôt que sur “les avantages décorrélés du travail” (mémo ANDRH 2021). En clair, depuis 5 ans, il n’est plus seulement question de faire profiter les collaborateurs de cours de yoga, mais aussi et surtout d’inviter les entreprises à repenser :
- Leurs pratiques managériales ;
- Le maintien durable dans l’emploi ;
- Les trajectoires professionnelles ;
- La conduite des transformations ;
- Les relations interpersonnelles.
Les salariés sont ainsi encouragés à s’exprimer sur leurs conditions de travail, leur environnement physique, leurs relations, et le contenu même du travail.
QVCT : que dit la loi ?
En 2025, la qualité de vie et des conditions de travail ne relèvent plus de la seule bonne volonté des employeurs. Elle s’inscrit désormais dans un cadre légal clair et structurant, né de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 9 décembre 2020 sur la santé au travail, puis renforcé par la loi du 2 août 2021.
Ce socle législatif engage les entreprises à intégrer la QVCT dans une logique de prévention globale, articulée autour de plusieurs obligations clés :
- Évaluer et prévenir les risques professionnels, y compris les risques psychosociaux (RPS), dans une approche anticipative et durable ;
- Actualiser le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) au moins une fois par an, et le conserver pendant 40 ans pour assurer une traçabilité des actions ;
- Définir un programme annuel de prévention (obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés), comprenant des mesures concrètes, des moyens associés et des indicateurs de suivi ;
- Associer les représentants du personnel (notamment le CSE) à l’élaboration et au suivi des actions liées à la QVCT, dans une logique de co-construction ;
- Mobiliser les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour accompagner les entreprises sur le diagnostic des conditions de travail, la prévention, le maintien en emploi, et les transformations organisationnelles.
En clair, la loi invite les entreprises à intégrer la QVCT dans leur stratégie sociale et managériale, au même titre que la sécurité ou la performance.
L’ANI du 9 décembre 2020, à l’origine de ces évolutions, rappelle d’ailleurs que l’amélioration des conditions de travail doit être au service à la fois du bien-être des salariés et de l’efficacité de l’entreprise.
Les acteurs et les outils de prévention QVCT
Un écosystème d’acteurs renforcé
En 2025, la prévention des risques psychosociaux et l’amélioration des conditions de travail s’appuient sur un réseau d’acteurs élargi et mieux coordonné. Les entreprises peuvent s’appuyer sur :
- Les services de prévention et de santé au travail (SPST), dont le rôle a été renforcé depuis la loi de 2021. Ils interviennent dans l’analyse des risques, la conception de plans d’action, l’accompagnement des transformations ou le maintien dans l’emploi.
- Le CSE, acteur central du dialogue social, obligatoirement consulté sur les sujets QVCT et associé à la co-construction des démarches.
- Des professionnels externes spécialisés : psychologues du travail, ergonomes, intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), médiateurs, coachs certifiés…
- Les réseaux de l’Anact et des Aract, qui proposent des ressources, formations et accompagnements pour structurer les démarches QVCT.
- Les Carsat, qui continuent de jouer un rôle clé en matière de prévention des risques professionnels, notamment via des diagnostics de terrain et des subventions pour les TPE/PME.
Des outils concrets à disposition
L’outil central reste le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels), qui doit recenser l’ensemble des risques, y compris les risques psychosociaux, et définir les actions de prévention à mener. Il doit :
- Être mis à jour au moins une fois par an (pour les entreprises de plus de 11 salariés), ou après tout changement important ;
- Être conservé pendant 40 ans, conformément à la loi ;
- Inclure un programme annuel de prévention, détaillant les actions, les ressources mobilisées, les échéances et les indicateurs de suivi (obligatoire à partir de 50 salariés).
D’autres outils viennent compléter ce socle :
- Baromètres internes QVCT : sondages réguliers pour mesurer la perception des collaborateurs, identifier les signaux faibles et ajuster les actions ;
- Grilles de repérage des RPS, souvent fournies par les SPST ou l’INRS, pour évaluer la charge mentale, la qualité du management ou le climat social ;
- Portails de signalement ou d’écoute : dispositifs de plus en plus fréquents (interne ou via prestataires) permettant aux salariés d’exprimer leurs difficultés en toute confidentialité ;
- Référentiel national QVCT (ANACT/ARACT), de plus en plus utilisé comme guide structurant pour les plans d’action.
Comment mettre en place une démarche QVCT ?
La mise en œuvre d’une politique QVCT passe par une démarche structurée en plusieurs étapes, avec une priorité accordée à la prévention primaire, c’est-à-dire agir en amont des difficultés.
Clarifier les objectifs et les enjeux
La QVCT ne se limite pas à des actions de bien-être ponctuelles : elle doit s’inscrire dans la stratégie RH globale de l’entreprise. Cela suppose de :
- Définir des enjeux clairs (ex. : limiter le turnover, améliorer l’attractivité, prévenir les RPS),
- Formaliser les objectifs à court, moyen et long terme,
- Mettre en place une gouvernance dédiée, souvent via un comité de pilotage QVCT associant RH, direction, CSE et parfois des collaborateurs volontaires.
Réaliser un diagnostic partagé
Le diagnostic QVCT reste une étape incontournable en 2025. Il repose sur :
- Une analyse des indicateurs RH (absentéisme, turnover, accidents du travail, alertes internes),
- Des enquêtes ou baromètres internes (QVT, climat social, perception managériale),
- Des entretiens qualitatifs, ateliers collaboratifs ou observations de terrain.
Ce diagnostic doit permettre de croiser les ressentis et les faits objectifs, afin de prioriser les actions.
Élaborer un plan d’action concret
Du diagnostic découle naturellement le plan d’action QVCT, c’est-à-dire les mesures concrètes que vous vous engagez à déployer au sein de l’entreprise. Celui-ci doit être co-construit avec les parties prenantes, réalité (en adéquation avec les ressources disponibles) et évaluable (avec des indicateurs de suivi clairs et mesurables.
Mais surtout, il doit s’inscrire dans la durée et faire l’objet d’ajustements réguliers. L’objectif : transformer l’entreprise sur le long-terme pour assurer aux collaborateurs une bonne qualité de vie au travail et des conditions optimales pour s’épanouir au sein de leur entreprise.
À noter qu’en 2025, il est de plus en plus courant de lier le plan QVCT au DUERP, pour garantir cohérence et pilotage transversal.
Renforcer la prévention secondaire et tertiaire
En complément de la prévention primaire :
- La prévention secondaire passe par la formation des équipes RH, managers et encadrants à la détection des signaux faibles, à l’écoute active et à la gestion du stress.
- La prévention tertiaire consiste à accompagner les salariés déjà en difficulté, via des dispositifs d’écoute (interne ou prestataire), des référents QVCT ou des cellules de soutien psychologique.
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises mettent en place des “points QVCT” réguliers dans les équipes (l’équivalent d’un check-in bien-être) pour agir avant que la situation ne se dégrade.
Comment évaluer la qualité de vie au travail ?
Les principaux risques psychosociaux référencés sont le stress au travail, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la violence au travail.
Facteurs de risques et conséquences
Afin de prévenir ce genre de situations, il est indispensable d’identifier :
- Les facteurs de risques psychosociaux : surcharge de travail, tâches répétitives, climat social délétère, relations managériales compliquées… peuvent engendrer épuisement ou burn-out, et d’autres signes d’usure professionnelle et/ou de souffrance au travail.
- Les risques liés à de mauvaises conditions de travail des salariés : risques métiers (dangerosité, pénibilité), accident du travail, maladie professionnelle, absentéisme, et dans le pire des cas, suicide au travail.
Les conséquences peuvent être désastreuses du point de vue humain, du point de vue de l’entreprise (déficit d’attractivité), mais aussi d’un point de vue économique (coût pour l’entreprise et pour la sécurité sociale).
Les indicateurs QVCT à surveiller
Les impacts des RPS tant sur la santé physique et la santé mentale que sur la qualité du travail peuvent être considérables. Le travail de prévention s’effectue, entre autres, grâce à certains indicateurs.
Indicateurs quantitatifs
- Le taux de turnover et le taux d’absentéisme : s’ils sont élevés ou en augmentation, ils peuvent révéler un désengagement, un mal-être au travail ou une surcharge.
- Le taux d’accidents du travail, d’inaptitudes et de maladies professionnelles : ces données sont directement liées aux conditions de travail, à la sécurité et à la prévention.
- Le nombre d’arrêts longue durée : un indicateur souvent révélateur de pathologies liées au stress chronique ou à l’épuisement professionnel.
Indicateurs qualitatifs
- La perception de la qualité du travail : plus subtile à mesurer, elle peut être recueillie via des enquêtes internes, baromètres RH ou entretiens. Elle renseigne sur le sens, l’autonomie, la charge mentale ou encore les relations managériales.
- Les résultats des baromètres QVCT ou de climat social : ils permettent d’identifier des signaux faibles (stress, sentiment d’utilité, reconnaissance, charge émotionnelle…).
- Le nombre de sollicitations des dispositifs d’écoute et d’accompagnement (psychologue du travail, lignes d’écoute, médiation interne…).
- Les feedbacks managériaux : recueillis lors d’entretiens professionnels, de revue d’équipe ou d’ateliers participatifs, ils apportent un éclairage terrain sur l’ambiance, les tensions éventuelles ou les irritants organisationnels.
Les nouveautés 2025 en matière de QVCT
En 2025, la QVCT prend une place plus stratégique dans les entreprises, portée par l’urgence des enjeux de santé mentale et les exigences réglementaires. Voici les grandes évolutions qui marquent les pratiques cette année.
La santé mentale au cœur des politiques RH
La santé mentale s’impose comme un pilier incontournable de la QVCT. Finie l’approche ponctuelle : elle devient un sujet suivi, mesuré, piloté. Baromètres de bien-être intégrés aux enquêtes internes, cellules d’écoute psychologique, lignes de soutien, temps de parole dédiés…
Les entreprises pionnières font désormais de la santé mentale un indicateur de performance sociale à part entière. Cette approche systémique permet d’anticiper plutôt que de réparer, en agissant sur les causes plutôt que sur les symptômes.
Une évaluation plus structurée et continue
Les démarches QVCT gagnent en maturité. Elles ne se limitent plus à des déclarations d’intention ou à des dispositifs isolés. De plus en plus d’organisations s’appuient sur le référentiel national QVCT pour structurer leur diagnostic et orienter leurs actions.
Le lien entre QVCT et DUERP se renforce, assurant une meilleure intégration des risques psychosociaux dans la politique globale de prévention. L’évaluation devient régulière, suivie et partagée avec les partenaires sociaux.
Des managers mieux formés et impliqués
En 2025, les managers ne sont plus de simples exécutants de la stratégie QVCT : ils en sont des leviers. Sensibilisés aux enjeux de charge mentale, aux signaux faibles, et aux tensions interpersonnelles, ils sont de plus en plus nombreux à être formés au management bienveillant, à la posture d’écoute et à l’animation de temps collectifs autour du travail réel. Leurs retours deviennent précieux pour ajuster les dispositifs au plus près du terrain.
Un télétravail plus encadré et mieux intégré
Le travail hybride est désormais la norme dans de nombreux secteurs, mais il ne va plus de soi. En 2025, les entreprises encadrent mieux les pratiques pour éviter les dérives observées depuis la crise sanitaire. Droit à la déconnexion réellement appliqué, clarification des attendus, accompagnement au travail à distance…
Le télétravail responsable s’inscrit pleinement dans les accords QVCT, qui intègrent aussi des mesures de régulation de la charge mentale et de maintien du lien collectif.
Inclusion, diversité et conditions de travail : une convergence naturelle
La QVCT devient aussi un vecteur d’inclusion sociale. Au-delà du bien-être, elle s’ouvre à la question des parcours et de l’équité : intégration des publics en situation de handicap, attention portée à la diversité générationnelle, adaptation des conditions de travail aux réalités de chacun. Cette vision inclusive ne s’ajoute pas : elle devient indissociable de la démarche QVCT.
Une articulation renforcée avec les politiques RSE
Enfin, la QVCT se connecte plus fortement aux engagements environnementaux, éthiques et sociaux des entreprises – c’est-à-dire à leur politique RSE. On parle désormais de QVT systémique, qui prend en compte non seulement le bien-être des salariés, mais aussi l’impact global du travail sur l’environnement, la société, les parties prenantes. Un mouvement de fond qui pousse les entreprises à penser leur modèle de façon plus durable, plus juste, plus cohérente.